




 |
 |
 |
 |
Lyon par Jules Lermina |  |
||||||||
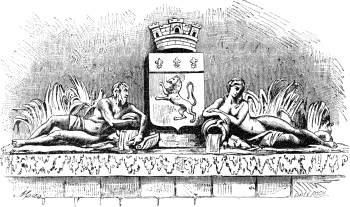
Au moment de prendre la plume pour commencer cette étude, ce tableau de la "grande et aimable" ville de Lyon, selon l'expression de Michelet, on se sent pris malgré soi d'une hésitation involontaire. On a dit de l'histoire de France qu'elle devait être écrite en un ou en cent volumes.
Ainsi, pour décrire Lyon, il faudrait la concision de quelques pages ou le développement de plusieurs volumes.
Pas une cité ne présente un caractère plus complexe, pas une population ne mérite une étude plus attentive. Lyon est une nation dans la grande patrie : il a ses fastes glorieux et ses annales héroïques, ses légendes et ses aventures douloureuses ou sublimes. Ses monuments sont des pages d'histoire : chacune de ses rues, de ses places, a été le théâtre de quelque grand fait, et sur les pavés de ses avenues, on peut retrouver les traces de tout un passé de luttes et d'efforts : traces, hélas ! trop souvent sanglantes, rappelant l'éternel combat des déshérités contre les oppresseurs.
Il sera donné à notre époque d'éteindre à jamais ces souvenirs : pour la première fois peut-être, la noble cité du travail respire librement, largement. La grande voix qui s'élève des hauteurs de la Croix-Rousse salue avec joie l'oeuvre nouvelle. L'effort pacifique succède aux antagonismes irritants ; le progrès recommence sa marche interrompue par les violences intéressées. Lyon se courbe sur son métier, et le travail qui, selon le mot du poëte, est la vraie prière de l'humanité, est en même temps le premier hommage que rend à la liberté la ville aujourd'hui confiante dans l'avenir.
De la célèbre devise révolutionnaire des Lyonnais, le premier terme subsiste seul : Vivre en travaillant ; et ces trois mots résument les aspirations les plus honnêtes et les plus respectables de cette énergique population.
Le travail est ici le fait dominant ; et justement en raison de cette spécialité, Lyon offre au penseur un exemple presque unique de ce que sont les illusions, les déconvenues, les convoitises, les triomphes, les défaites de ceux qui ne vivent que pour et par le travail.
A Lyon, tout procède de l'effort que les Anglais ont si bien caractérisé par ce mot : The struggle for life, la lutte pour la vie.
Le point caractéristique, topique des Lyonnais, est celui-ci : "Travailler le plus possible, aux meilleures conditions possibles, mais avec cet objectif : Vivre le mieux possible".
Voyez les tisseurs, les fameux Canuts, comme on les appelait jadis : ils travaillent pour vivre, mais ce mot "vivre", ils l'entendent dans son acceptation véritablement pratique et large.
Le tisseur gagne-t-il quatre-vingts francs dans une semaine ? Il les dépense. L'économie, l'épargne, sont morts pour lui. Cet argent, acquis aux prix d'un labeur opiniâtre, surmené, représente pour lui une certaine somme de jouissances dont il n'entend pas se priver en vue de l'avenir.
Il n'est point de ceux qui renoncent au superflu sans se réserver même le nécessaire ; il rêve la vie relativement complète, satisfaite.
Type curieux qui est un enseignement.
Se fatiguer, volontiers, mais se réparer.
L'ouvrier lyonnais a la franchise de sa théorie.
S'il n'a rien, il accepte toutes les privations. S'il a, il les rejette toutes. Il entend se payer ce que son argent peut lui donner.
Mais je m'arrête, ces observations devant trouver meilleure place au courant de cette rapide étude. J'ai voulu cependant établir tout d'abord que Lyon était une ville type, ce dont bien peu se doutent, y compris les indigènes. Et maintenant, sans autre préambule, j'entre de plein pied dans mon sujet.I
Lyon à vol d'oiseau
Qui décrit une ville s'adresse avant tout à ceux qui ne la connaissent pas, et le point vraiment difficile c'est de donner à ceux-là une idée nette, claire, exacte, qui leur permette de comprendre à la fois et sa topographie et en quelque sorte son entité morale.
Lyon n'est pas seulement une grande cité, la vice-reine de France, comme a dit Dumas, auquel j'adresserais un reproche : c'est de n'avoir consacré à cette vice-reine qu'une dizaine de pages, sèches et sans intérêt.
Essayons de faire plus, sinon mieux.
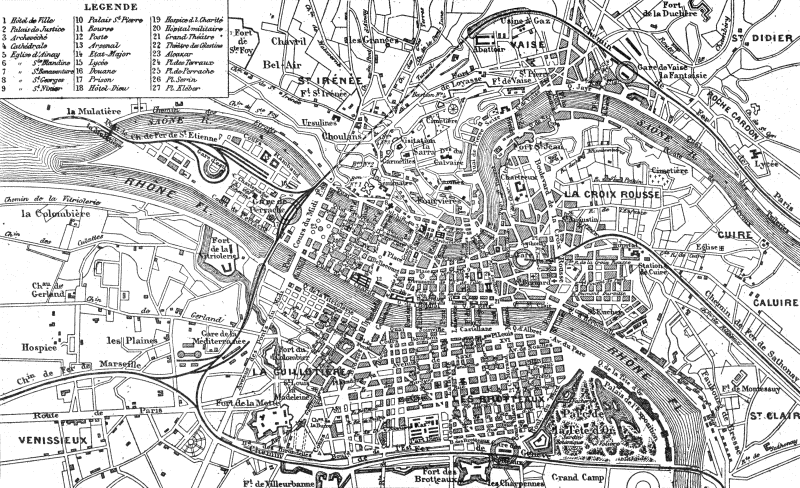
En premier lieu, je demande à mes lecteurs d'étudier avec moi le plan de la grande ville et de suivre avec soin les indications que je vais m'efforcer de leur donner.
Un mot d'abord.
Quelle est l'origine du nom de Lyon ? Les Latins disaient Lugdunum, ou mieux Lucdunum. Les Grecs écrivaient Lougdounon.
Ici commence la féroce bataille des étymologistes.
Plutarque - ou du moins un traité qui lui est attribué - tranche nettement la question. Lougon aurait signifié, en langue celtique, corbeau et Dounon (Dun) éminence. Combinez cette hypothèse avec un groupe de corbeaux venant se poser sur les fondations de la ville, et voilà qui est fait. Il est vrai que Camden déclare que Lugum en celte signifiait tour, et qu'un autre auteur rappelle qu'en irlandais Lough est lac, cette dernière opinion s'appuyant sur l'ancienne configuration de la ville qui se terminait par une sorte de cloaque à Saint-Martin-d'Ainay.
Pour ne rien omettre, nous mentionnerons encore Lucus, bois sacré, par allusion au temple d'Auguste, à la construction duquel contribuaient presque tous les peuples gaulois.
Cela pour la science.
Mais ce nom de Lyon - dépouillé de tout son attirail de linguistique - me frappe plus que je ne saurais dire quand je jette les yeux sur le plan de la ville. On dirait une dénomination symbolique.
Ne retrouvez-vous pas dans cette presqu'île longue, aux lignes nerveuses et nettes, la silhouette du Lion, dont la tête énorme se dresse à la Croix-Rousse, tandis que sa croupe arrondie s'appuie à Perrache ? Le vigoureux animal s'est accroupi au bord de deux cours d'eau qui, sans se troubler, roulent auprès de lui leurs flots énormes.Regardons, maintenant.
Juste au milieu du plan, vous remarquerez une sorte de parallélogramme bordé d'un côté par la rue Louis-le-Grand, de l'autre par la rue du Pérat.
C'est la place Bellecour. Il y a deux cents ans à peine, c'était encore un cloaque, une sorte de marais, que venaient remplir, à chaque crue, les eaux de la Saône.
Au milieu, la statue de Louis XIV, par Lemot, dont un roi disait, en visitant les ateliers : - "Quand on travaille ainsi, on coule sa réputation en bronze".
Il est vrai que Lemot, volontaire de la République, puis adulateur de Napoléon, finit par recevoir de la Restauration le titre de baron : tout en lui n'était pas bronze, comme on voit.
Cette statue n'est d'ailleurs qu'un hommage posthume à celui qui édicta la révocation de l'édit de Nantes et faillit ruiner Lyon. Le peuple avait renversé en 1792, et avec justice, le symbole d'un des actes les plus odieux dont ait souffert la France. Cette première statue avait été fondue par les frères Keller, sur les dessins de Desjardins. On la jeta bas et on fit bien. Et, si on nous accuse de vandalisme, nous répondrons qu'à l'heure actuelle, comme le rappelait dernièrement un journal, il existe dans l'armée allemande plus de 300 officiers d'origine française, descendants de familles que l'amant de la Maintenon a chassées pour complaire à sa maîtresse et aux jésuites.
A l'est et à l'ouest du piédestal, on avait placé des groupes en bronze, le Rhône et la Saône, oeuvre des frères Coustou, nés tous deux à Lyon, Nicolas en 1658, Guillaume en 1678. Disons, en passant, que Guillaume Coustou fut un des plus grands caractères du XVIIIe siècle. Ainsi fut Puget, le grand Marseillais. Ces hommes-là furent citoyens, même à la cour de Louis XIV et de Louis XV, et, refusant de s'abaisser au rôle de plats courtisans, défendirent en leur personne les droits imprescriptibles de l'art et de la dignité humaine.
Guillaume, mourant de faim, ne se vautrait pas dans les anti-chambres. Il allait bravement au milieu des mendiants déguenillés et sollicitait un engagement sur la marine marchande.
A un financier ventru qui lui demandait de sculpter un magot : - "Je le veux bien, disait-il, mais il me faut un modèle : asseyez-vous".
Les deux statues ont été transportées à l'Hôtel de Ville : ce sont des chefs-d'oeuvre de forme et de grâce.
La place Bellecour a été l'objet d'une faveur particulière : le 18 avril 1805, du haut d'un balcon de la maison qui porte le numéro 22, dite Maison Henry, Pie VII donna sa bénédiction à la foule rassemblée sur la place. Il est vrai qu'il obéissait à un cas de force majeure, et qu'il venait accepter le Concordat.
Posez le doigt sur cette place Bellecour, qui est le centre de Lyon et dont nous reparlerons plus loin, et dirigez votre regard vers la droite. Ici, la place des Jacobins, d'où partent deux des grandes artères de Lyon central, la rue Centrale et la rue de l'Hôtel-de-Ville. Un peu plus bas, la rue de Lyon.
Remarquez, en passant, qu'il y a six ans, ces deux dernières rues se nommaient : Rue Impériale, rue de l'Impératrice.
Je crois qu'il n'existe pas en France de ville où l'Empire ait plus violemment tenté d'imprimer son stigmate.
Il y avait une place Louis-Napoléon (place Perrache), un pont Napoléon (pont du Midi), une place de l'Impératrice (place des Jacobins), un quai du Prince-Impérial (quai de la Vitriolerie), sans compter les rues mentionnées plus haut.
Tout cela est effacé, et le nom des rues indique maintenant soit leur situation, soit les monuments qui les bordent. Ceci vaut mieux, et toutes les précautions prises ne prévalent pas contre la logique.
Donc les trois rues que nous venons de nommer constituent, à vrai dire, ce que nous appellerons le Lyon parisien.
La rue de l'Hôtel-de-Ville, la rue de Lyon, reliant la place Bellecour à la place de la Comédie (Grand-Théâtre), sont, à Lyon, ce que représentent ici le boulevard Montmartre ou des Italiens.
Seulement, elles ont cet immense avantage de relier effectivement le Lyon oisif, flâneur, au vrai Lyon travailleur, qui commence à la place des Terreaux ou, mieux encore, à la rue Puits-Gaillot.
Suivez bien sur le plan : voyez cette rue Puits-Gaillot, qui va du pont Morand (quai Saint-Clair) au pont de la Feuillée (quai d'Orléans). Cette ligne est capitale dans le dessin de la cité lyonnaise.
A gauche, c'est-à-dire vers Bellecour, Lyon qui s'amuse, les théâtres, les cafés de luxe, les restaurants. A droite, vers la Croix-Rousse, le travail, le commerce, la gloire lyonnaise.
La rue de Lyon est large, spacieuse : elle tient à la fois du boulevard de Sébastopol à Paris et de la rue de Noailles à Marseille. C'est là que les magasins étalent leur luxe, que les dames lyonnaises vont shopping, selon l'expression anglaise.
La rue Centrale rappellerait plutôt la rue Saint-Denis. C'est la boutique de détail : mercerie, rubanerie, et cette destination n'est pas nouvelle, ainsi que l'indique le nom de la rue Mercière qui la touche.
Dans la rue de Lyon, le commerce à grandes guides, si nous pouvons employer cette expression ; dans la rue Centrale, les petites affaires.
La rue de l'Hôtel-de-Ville est moins fréquentée, presque triste.Nous voici à la place des Terreaux, qui s'étend au pied de la Croix-Rousse comme le carrefour où viennent aboutir et se rencontrer toutes les classes travailleuses de la grande ville. Et sous ce titre nous comprenons, on le devine, les grands fabricants comme les propriétaires de métiers.
La place des Terreaux est riche en souvenirs historiques, point que nous reverrons au chapitre suivant.
Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la physionomie générale. Or, la place des Terreaux et la place de la Comédie sont peut-être le centre le plus animé des Deux Mondes. C'est la place Saint-Georges à Liverpool, Threadneedle street à Londres : à Paris nous ne voyons pas d'équivalent. A Paris, on entre dans les cafés. Sur la voie publique, on entendrait, même aujourd'hui, le : Circulez ! sacramentel.
A Lyon, la place de la Comédie appartient aux brasseurs d'affaires. Ils forment groupe, discutent, pérorent, traitent, transigent. Cette place est une fourmilière.
Sous les arcades du Grand-Théâtre, chaque pilier sert de centre à un conciliabule.
C'est là encore que les maîtres-ouvriers de la Croix-Rousse viennent discuter les questions de tarif, les grèves, les réclamations à adresser aux patrons.
Mais nous voici à la rue Puits-Gaillot ; nous allons toujours vers la droite.
Ici, le point de vue change : du Lyon parisien, nous passons rapidement au Lyon lyonnais.Descendons vers le Rhône : le quai Saint-Clair longe le fleuve. C'était là autrefois le véritable centre du commerce lyonnais : les quais de Retz et Saint-Clair étaient le rendez-vous des négociants et des étrangers ; depuis cette époque, la rue de Lyon a détrôné les quais, dont l'aspect cependant était cent fois plus pittoresque que celui de ces maisons modernes, à étages multiples. Il n'est pas un Lyonnais de trente ans qui n'ai gardé le souvenir du café de la Perle, une des gloires disparues, et dont la mémoire ne subsiste plus que par le nom de "Maison de la Perle" donné à un des bâtiments du quai de Retz.
Du quai à la gare de Sathonay, ce ne sont que grandes maisons de soieries : la place des Capucins, la place Croix-Paquet, regorgent de magasins et de bureaux ; c'est l'avant-garde de la Croix-Rousse, vers laquelle commencent à monter deux rues d'aspect pittoresque, la montée du Griffon et la Grand'Côte.
Sur le boulevard de la Croix-Rousse s'appuie la colline qu'on a souvent appelée le mont Aventin de Lyon, et dont l'aspect est particulièrement pittoresque.
Etagées en amphithéâtre, les maisons de la Croix-Rousse, d'une hauteur énorme, d'une largeur singulière, s'ouvrent sur la ville par des centaines d'énormes fenêtres qui, le soir, semblent autant d'yeux de félins braqués sur la ville basse.
Suivant le boulevard de la Croix-Rousse, en marchant vers la Saône, on rencontre de larges espaces presque déserts, terrains vagues qui confinent aux Chartreux.
C'est là qu'en 1871 s'est passé le drame terrible qui a coûté la vie au commandant Arnaud.
Le lecteur qui a bien voulu nous suivre pas à pas, connaît maintenant grosso modo et sous son aspect le plus large cette partie de la presqu'île qui s'étend de l'hôpital de la Croix-Rousse à Bellecour.Revenons à cette place et dirigeons-nous vers la Mulatière qui forme, comme on sait, l'extrémité du faubourg de Perrache.
De la rue du Pérat qui borde sur la gauche la place Bellecour, au cours du Midi, est le quartier essentiellement aristocratique, c'est-à-dire la rue de Bourbon, avec de grandes maisons assez simples d'apparence, où se sont réfugiées les familles parlementaires, la noblesse d'épée et la noblesse de robe, la rue Saint-Joseph, la rue Vaubecour. Rien de particulier : quartier triste, sans animation, qui semble bouder encore et peut-être aujourd'hui plus que jamais. Et cependant, bien des parvenus, ayant acquis leur richesse par le travail, ont déjà forcé la barrière de la rue du Pérat. Le mélange se fait et s'accentue tous les jours davantage.
C'est à l'entrée de la rue Bourbon que se trouve l'hôtel, d'ailleurs fort mesquin, du commandant de la place.
Cette rue aboutit à une place immense qui portait, naguère, bien entendu, le nom de place Napoléon, et qui se développe devant la gare de Perrache.
Les voyageurs qui débarquent dans la grande ville ne peuvent, en réalité, concevoir la moindre idée de ce qu'est le vrai Lyon. En face d'eux, sur la place dont nous parlons, à peine quelques passants se hâtant sous la pluie ou le soleil. On dirait un vaste désert, bordé - ce qui le distingue des déserts africains - par d'immenses casernes.
Parfois la place s'anime : ce sont les manoeuvres, les exercices des mobiles, des réservistes. Mais Lyon est peu curieux de ces spectacles militaires, et les spectateurs manquent.
Parfois aussi des saltimbanques, tentés par la largeur de l'espace qui s'offre à eux, sollicitent l'autorisation d'y installer leurs baraques. Mais le gone de la Croix-Rousse préfère aller au quai Saint-Clair faire sa partie de boules, qui est sa passion favorite, et recule devant le long voyage qui lui impose une visite à Perrache.Nous voici donc devant la gare, qui ressemble à toutes les gares, ce que d'ailleurs je ne tiens pas à reproche, l'architecture industrielle devant avant tout présenter un caractère d'utilité pratique, et de solidité qui lui sied mieux que les fantaisies les plus capricieuses.
Derrière la gare, des docks, un arsenal, un abattoir, une prison, une caserne, puis la digue, à l'extrémité de laquelle la Saône se jette dans le Rhône.
Du quai de Rhône, si larges et si spacieux, le plus curieux - j'entends du côté de Bellecour - est le quai de l'Hôpital, avec ses bouquinistes, étalant leurs livres sur le trottoir, ses marchands d'oiseaux offrant aux acheteurs les perroquets les plus monumentaux, les canaris les plus gracieux, les colibris les plus délicats qui se puissent trouver en dehors de Marseille.
Un mot sur l'hôtel des Ventes qui fait presque le tour de la rue Grôlée et s'ouvre sur le quai de l'Hôpital. Et encore ce mot n'exprimera-t-il pas suffisamment ma pensée. Je ne sache pas qu'il existe dans une ville de troisième ordre cassine (qu'on me passe le terme) plus obscure, plus étroite, plus horrible. Voyons ! messieurs les commissaires-priseurs de la noble cité lyonnaise, est-ce que vous n'étouffez pas là dedans !...Du côté de la Saône, partant du fort Saint-Jean, qui garde la Croix-Rousse, avec la tendresse inquiète d'une belle-mère prête à fouailler les enfants d'un premier lit, nous suivons les quais Saint-Vincent, d'Orléans, quai Saint-Antoine.
Je ne conseillerais pas à un petit rentier de chercher à se loger sur ce dernier quai. Des fenêtres de ses vastes appartements on aperçoit, se découpant sur le ciel, la colline de Fourvières, qui fait face sur la route opposée et qui, avec les jouissances du pittoresque, donne sans doute aux locataires du quai le goût des méditations célestes, ce qui se paie très-cher.
Le quai des Célestins passe devant le théâtre en reconstruction, se soude au quai Tilsitt et se prolonge sous le nom de quai d'Orléans jusqu'au pont du Midi.Voilà qui est fait.
J'ai la prétention de croire que vous pouvez aller les yeux bandés maintenant de Perrache à la Croix-Rousse, et je vous demande la permission de vous entraîner au delà des ponts.Lyon négociant travaille à Saint-Clair et à la Croix-Rousse, et va se reposer aux Brotteaux, en passant sur le pont Morand. Suivez le cours du Rhône, du pont Morand, et marchant vers la gauche, prenez le quai d'Albret, le quai Castellane, le quai Joinville et arrêtez-vous au pont de la Guillotière, l'aîné du pont Morand. Puis descendez le cours de Brosses, jusqu'au boulevard de l'Est, le boulevard des Brotteaux, et remontez vers le Rhône par le boulevard du Nord.
Cette ligne enserre les Brotteaux dans un quadrilatère presque régulier.
Les Brotteaux présentent un double caractère très-tranché.
La riche bourgeoisie lyonnaise habite les places et les larges voies, la place Louis XVI, l'avenue de Saxe, de Noailles, le cours Morand jusqu'à la place Kléber, les rues Tronchet et Malesherbes, le quai d'Albret.
Par contre, toutes les rues étroites - Monsieur, Madame, Créqui, Duguesclin, Charlemagne et vingt autres - sont exclusivement occupées par des ouvriers. La place Saint-Pothin notamment est tout entière garnie de logements à bon marché.
En face du pont Lafayette, vous trouvez le cours Lafayette qui présente un caractère tout spécial : c'est l'Eldorado des revendeurs, des marchands de bric-à-brac. A mesure qu'on approche de la Part-Dieu, caserne qui fait sentinelle à l'extrémité de la plaine, ce ne sont plus qu'échoppes, bâtisses titubantes, où grouillent toutes les vieilleries, tous les détritus voiturés en masse de la grande ville, épaves de misère sur lesquelles s'accroupissent les écumeurs à profil d'oiseaux de proie, types éternels des Gobsecks et des Shyloks.
Que de fois on voit rôder, l'oeil indifférent en apparence, d'un pas indolent, l'amateur d'antiquités ! Il va, il passe, jetant autour de lui un regard dédaigneux. Mais à peine a-t-il mis le pied entre les deux pinces de la rue avide qu'il est signalé, reconnu, saisi, entraîné. Malheur à lui !... il en sortira saigné à blanc, et cependant heureux s'il a découvert une vieille faïence payée jusqu'à dix fois au delà de sa valeur.
Je dis cela pour que mes lecteurs ne croient pas à quelqu'une de ces mirifiques occasions qui font la joie des collectionneurs : le bouquiniste du quai de l'Hôpital rendrait des points à Charles Nodier, et le revendeur du cours Lafayette mettrait à mal Pillet et toute la cohorte des experts.
Le cours de Brosses a été percé en un jour d'énergie : les Brotteaux avaient honte et terreur à la fois du voisinage de la Guillotière, et un beau matin, elle s'est imaginé de se séparer d'elle en traçant un cordon sanitaire.
Qu'est-ce donc que la Guillotière ? et pourquoi les Brotteaux font-ils, avec leur compagne, qui les touche d'aussi près, ménage aussi détestable ?
C'est que la Guillotière !...
Interrogez un Lyonnais, et malgré lui, en vous répondant, sa voix se baissera d'un ton ; et vous pourrez, si vous êtes physionomiste, discerner sur son visage une sorte de terreur mal dissimulée ; pressez-le un peu, et alors, baissant la voix, il murmurera : - "Monsieur, à la Guillotière il y a quarante mille forçats".
Certes, le chiffre est respectable et expliquerait bien des épouvantes. La vérité est moins effrayante. Elle se réduit à ceci : comme toutes les villes rapidement haussmannisées, Lyon repousse toujours plus loin ses pauvres et ses déshérités. La misère s'écarte et se cache ; elle se réfugie là où ses haillons se confondent avec l'ombre. Et, comme elle, le crime cherche la nuit. Si bien que misère et crime se coudoient et se complètent dans une sorte de pandémonium sinistre.
C'est à la Guillotière qu'est échu ce sinistre privilège d'être à Lyon la cité des pauvres et des misérables. C'est de là que sort le murmure sans trève de ceux qui souffrent et de ceux qui convoitent.
"Ville populeuse, laide et malpropre" disent les guides officiels.
Città dolorosa, cité douloureuse, voilà le mot propre.
Là, les rues étroites s'enchevètrent en un dédale sans issue ; les maisons basses titubent sur leurs poutres dépouillées comme les os d'un squelette ; on dirait que l'édilité lyonnaise a crainte de s'y hasarder. Les eaux croupissent au milieu des ruelles, formant des flaques pestilentielles, étouffant sous leurs miasmes délétères toute vigueur et toute énergie.
Et comme il est de règle - en notre société humanitaire - qu'on ne discute pas avec les misérables, trois forts, le Colombier, la Motte, les Hirondelles, enserrent la Guillotière, prêts à l'écraser, si sa clameur prenait le caractére d'une revendication ou d'une menace.
Repliée sur elle-même, la Guillotière vit seule, dans ses demeures malsaines, qui semblent des repaires, dans ses cabarets qui sont des bouges. C'est le gouffre dans lequel tombent toutes les victimes de l'inconduite ou de la fatalité.
C'est là ce que les Lyonnais appellent les "forçats".
Le jour où la société, au lieu de jeter l'anathème irraisonné, consentira à mettre à l'étude la question de misère, ce jour-là, l'effroi fera place non-seulement à la pitié, mais encore à la notion de cette vérité formulée par le premier penseur de notre époque : "Les causes du paupérisme et du crime se réduisent à une seule : le droit économique partout violé".
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de reparler des Voraces, ainsi qu'on nomme ces lépreux de la civilisation lyonnaise, et peut-être nous sera-t-il donné de prouver que si, selon le vieux dicton, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, il est plus vrai que la crainte de l'homme est le summum de la folie.
Au delà de la Guillotière, des plaines, des guinguettes, des terrains vagues. Lyon ne s'est pas encore étendu au delà : il semble que ce quartier haï soit une digue.Revenons maintenant, s'il vous plait, vers le Rhône. Traversons le pont du Midi, le cours du Midi, franchissons la Saône. Nous parvenons à la rive droite.
Examinez le plan.
Vous y trouverez ces seuls mots : Carmélites, Séminaires, Visitation, la Sarra, Dames du Calvaire ; ces dénominations à parfum mystique vous prouvent, si peu que vous ayez entendu parler de Lyon, que vous approchez de Fourvières.
Ici le lecteur n'attend pas que je décrive ce sanctuaire révéré en quelques lignes. Point. Fourvières, c'est le Vatican de Lyon, c'est l'arche, le palladium. Il n'y faut toucher qu'avec précaution. La malédiction est suspendue sur la tête du sceptique. Honte aux fils de Voltaire et raca aux adversaires du Syllabus.
Donc nous parlerons de Fourvières, des séminaires et des Providences à notre grand loisir ; nous soulèverons discrètement ces étoles, ces chasubles, nous retournerons ces ex-voto et nous tenterons de savoir ce qu'il y a dessous.
Lyon ! Lyon !... quand donc te débarrasseras-tu de ce suaire de Nessus ?Passons donc et terminons notre rapide exploration par le faubourg de Vaise.
Lyon eut jadis sa Bastille, sur le rocher de Pierre-Scise, à Vaise. Ce fut encore un des crimes de la première république, dirait Mons Veuillot. Mais on la jeta bas, et Pierre-Scise n'est plus qu'une carrière.
Vaise porta jadis le nom de Bourg-d'Eau. Les bons bourgeois qui y vivent maintenant ne se soucieraient guère de se rappeler le passé, alors que le roi des Ribauds promenait par les rues de Vaise les vierges folles saisies en flagrant délit dans la ville.
Vaise est, à vrai dire, une cité nouvelle : les inondations de 1840 avaient renversé les frèles constructions de bois qui y avaient été élevées ; depuis cette époque, Vaise a prospéré. La gare du chemin de fer a imprimé à ce faubourg son caractère moderne et sociable.
Il est un souvenir terrible auprès duquel pâlissent les scènes terribles des répressions parisiennes, aux jours d'émeute. Une maison de Vaise fut, le 12 avril 1834, le théâtre d'une horrible boucherie...
Tout cela est oublié !
Vaise est rentier et conservateur.Ainsi, les divisions de Lyon sont assez tranchées pour que, même à la simple étude du plan, le lecteur puisse en concevoir une idée aussi nette que possible.
Dans la presqu'île, la Mulatière, Perrache, Bellecour, Saint-Clair, la Croix-Rousse.
Sur la rive gauche du Rhône, les Brotteaux, la Guillotière.
Sur la rive droite de la Saône, Fourvières et Saint-Irénée, la cité de religion à laquelle nous consacrerons un chapitre spécial, et le faubourg de Vaise, industriel et commerçant, mais sans caractère spécial.II
Lyon historique
Dans ses Mémoires d'un touriste Stendhal consacre quelques pages à Lyon ; en vérité, il est difficile d'admettre qu'un des esprits les plus brillants du commencement de ce siècle ait si mal vu cette ville, dont il ne parle qu'avec une sorte de dédain.
Il règne dans cette courte étendue une sorte d'âpreté malveillante que rien ne justifie, et qui se résume en ce seul mot écrit à toutes les pages : Ennui ! Ennui !
"Lyon m'a rendu triste", dit-il ; et, pour lui, il croit avoir décrit la cité et compris le véritable esprit de sa population, quand il a raillé ses souvenirs, exagéré quelques défauts, aiguisé quelque critique acerbe, et plus hargneuse que spirituelle.
N'en déplaise à nos écrivains, pour qui Lyon semble avoir toujours été un épouvantail - témoin Dumas lui-même qui, malgré sa prolixité ordinaire, ne consacre à Lyon que deux cents lignes d'une banalité désespérante, - je sache peu de cités plus intéressantes, par cette raison que son histoire se confond avec celle de la France, que pas un grand événement n'a agité la patrie qui n'y ait eu son retentissement, et que nos plus anciennes annales se retrouvent taillées dans la pierre de ses monuments.
Mérimée lui-même a perdu toute sa verve en face de Lyon, et dans ses Notes d'un voyage dans le midi de la France, il ne s'est souvenu que de son titre officiel d'inspecteur des monuments historiques. Du moins, son étude, pour être courte et sèche, n'est-elle pas empreinte de la partialité quasi haineuse qui guidait la plume de Stendhal.
Nous allons tenter de reconstituer rapidement l'histoire de la ville à laquelle Rousseau adressait, au XVIIIe siècle, ces vers dithyrambiques :
Ville heureuse, qui fais l'ornement de la France,
Trésor de l'univers, source de l'abondance,
Lyon, séjour charmant des enfants de Plutus !
De mille éclats divers, tu brilles à la fois,
Et ton peuple opulent semble un peuple de rois !...Mes lecteurs ne seront pas peu surpris d'apprendre ce qu'était Lyon aux temps antédiluviens. Il est bien entendu que je n'affirme rien sur ma propre expérience, et je crois, sur la déclaration de deux savants, MM. Chantre et Lartet, que les anciens glaciers de la vallée du Rhône étaient semblables en étendue et en puissance à ceux du Groënland.
Les éléphants avaient pris possession de ce vaste territoire sur lequel la ville est construite aujourd'hui ; les environs sont un vaste cimetière d'éléphants. Leurs restes se rencontrent partout, même dans l'intérieur de la ville, et c'est dans l'une de ses rues qu'a été trouvé le beau squelette qui fait l'ornement du muséum.
A l'époque quaternaire, d'immenses forêts, des pâturages, des tourbières couvraient le territoire, donnant asile aux ours, aux rhinocéros, aux chevaux, petits et trapus, aux boeufs gigantesques.
"Entre ces glaciers et ces marécages, dit le remarquable travail de MM. Chantre et Lartet, s'élevaient des collines revêtues de forêts de sapins, d'épicéas, de pins ; dans les vallées, les frênes, les chênes, les bouleaux, les trembles et les aulnes formaient de sombres forêts... le renne hantait les lieux élevés, les plateaux et les abords de glaciers, afin de pouvoir facilement se coucher sur la glace et sur la neige. Les rongeurs fourmillaient partout, et la marmotte faisait entendre son sifflement strident et répété, pendant que la chouette harfang remplissait la forêt de son cri plaintif et prolongé. Le ciel devait être souvent gris et terne, l'air froid et surchargé d'humidité ; le soleil devait se montrer rarement sous ce rude climat. Tel devait être l'aspect de notre pays à l'époque glaciaire, lorsque notre race était encore à son aurore".Franchissons maintenant plusieurs milliers d'années.
Le territoire appartient aux Ségusiaves. Les Romains s'en emparent et fondent une première colonie. On adjoint aux Ségusiaves un des petits peuples de la Confédération éduenne. "César, disent les Commentaires, conduisit ses troupes dans le pays des Allobroges, puis chez les Ségusiaves, qui sont le premier peuple hors de la province au delà du Rhône".
Donc, en réalité, Lyon n'existait pas encore à l'époque de César, ainsi que le prouvent les études de M. Aug. Bernard ; cette ville ne fut fondée que quelques années après la conquête des Gaules. Comme colonie, elle jouit d'abord de certains privilèges qui la rendaient indépendante.
Elle acquit bientôt une importance telle qu'on la choisit pour être la métropole de la Celtique, qui prit même son nom, Gaule lyonnaise, lors de la première division régulière des Gaules, sous Auguste.
Plus tard, Agrippa lui donna une importance nouvelle.
"Lyon, dit Strabon, est placé au milieu de la Gaule et est comme le coeur de ce pays, tant à cause du confluent de deux grandes rivières qu'en raison de sa proximité de toutes les parties de cette contrée. C'est pourquoi Agrippa en fit le point de départ des grandes routes : la première, traversant les Cévennes, conduit en Aquitaine, la seconde au Rhin, la troisième à l'Océan, la quatrième à la Méditerranée".
Et Strabon ajoute - c'est Stendhal lui-même qui traduit - "que Lugdunum ne le cédait qu'à Narbonne pour l'importance et la richesse".
Elle fut réduite en cendres sous le règne de Néron, et Sénèque écrivit cette phrase admirable, qui fait le désespoir des traducteurs : "Una nox fuit inter urbem maximam et nullam"... "Entre tout et rien, il y eut une nuit".
Sous Dioclétien, à la fin du IIIe siècle, la Gaule fut divisée en deux provinces, Première et Seconde Lyonnaise, ayant pour chefs-lieux Lyon et Rouen. Un siècle plus tard, les divisions furent portées au nombre de quatre. Les deux nouveaux chefs-lieux étaient Tours et Sens.
Mais, on le voit, Lyon était en réalité la métropole des Gaules, la primatiale de la Celtique, le chef-lieu de trois provinces chevelues : Aquitaine, Belgique et Celtique. Au IVe siècle, quand Alaric vint menacer Rome, on songea à transporter dans la cité nouvelle le siége de l'Empire romain.
C'est que déjà "la civilisation avait entièrement brisé l'ancien ordre de choses et transformé la Gaule". Lyon était devenue le centre des affaires de l'Occident.
Détail curieux, Lyon fut tout d'abord une colonie d'exilés. Lucius Plancus s'empara du petit bourg des Ségusiaves et y fonda un établissement pour une partie de la population de Vienne, qui en avait été chassée à la suite de dissensions civiles. Est-ce donc cet ancien noyau de lutteurs qui a germé à travers les siècles et qui a laissé dans l'esprit lyonnais le caractère d'indépendance presque indomptable que rien ne peut ni ne pourra jamais abattre ?
Lyon, ville batailleuse, défend jusqu'à la mort le parti qu'elle a embrassé ; en 197, après l'assassinat de l'empereur Pertinax par les prétoriens, deux compétiteurs se disputent l'empire : Lyon défend Albinus, mais Sévère s'en empare, la réduit en cendres et passe les habitants au fil de l'épée. Puis la ville se jette dans les bras du christianisme ; Pothin, et après lui Irénée, périssent martyrs avec plus de 2.000 habitants.
Nouvelles catastrophes : Lyon est pris d'assaut et pillé par les barbares. Au VIIIe siècle, les Sarrasins saccagent et détruisent la ville. Avec Charlemagne, commence une ère de calme pendant laquelle elle se relève de ses ruines.
On nous pardonnera de passer rapidement sur ces périodes éloignées dont l'étude rentrerait mieux dans un travail purement historique.
Sous Charlemagne, Lyon se relève et, à sa mort, devient la capitale du royaume de Provence : puis par une de ces vicissitudes si fréquentes aux temps de la grande féodalité, l'archevêque de Lyon, Burchard II, usurpe le pouvoir temporel et devient le souverain de Lyon.
Mais la bourgeoisie lyonnaise, fatiguée de l'oppression ecclésiastique, lutte pendant plus d'un siècle. Elle fait appel aux rois de France, Louis IX, Philippe le Bel, et enfin Louis le Hutin, s'efforçant d'arracher la ville à l'usurpation, et enfin, au XIVe siècle, Lyon recouvre le droit de se gouverner elle-même par douze consuls élus.
Qu'il nous soit permis de nous arrêter ici un instant. L'auteur qui écrit ces lignes professe - il l'avoue hautement - une réelle admiration pour le seul roi de France qui, à son sens, ait été digne du rôle que lui assignait son époque. Cet homme, c'est Louis XI. Et c'est avec une véritable joie qu'il saisit cette occasion de lui rendre un hommage qui est, non pas le premier, mais du moins une des plus publiques réponses qui aient été adressées aux calomniateurs du seul souverain pour lequel la France doive, malgré son état royal, conserver quelque reconnaissance.
Dans le chapitre suivant, nous expliquerons ce que Louis XI a fait pour l'industrie lyonnaise, dont il est le vrai créateur. Ici, laissons la parole aux faits politiques.
Ce fut à Lyon que, le 6 mai 1476, Louis XI signa avec le roi René le traité qui donnait la Provence à la France.
Pétrarque était venu passer à Lyon une partie du mois d'août 1330, et en avait fait dans ses lettres une description éloquente. Plus tard, en 1419, Gerson y avait passé les dernières années de sa vie. C'est là, sur la rive gauche de la Saône, que fut écrite cette Imitation qui, si discutable qu'elle soit, n'en est pas moins la plus splendide expression de la vie spirituelle, de la pensée, contre les brutalités du moyen age.
Bientôt à l'étroit dans le triangle dont le sommet est vers le Sud, au confluent des deux cours d'eau, Lyon s'est étendue au loin sur les quatre rives de ses fleuves, elle a envahi toutes les hauteurs qui la dominent au nord et à l'ouest.
Les privilèges accordés aux habitants étaient de nature à en augmenter le nombre.
"Un bourgeois vend son vin sans payer aide ni octroi : les ouvriers de tous métiers exercent librement leur profession et sans payer maîtrise ; les citoyens ont les clefs de leur ville. Ils montent la garde chaque jour et à tour de rôle. Ils sont enrégimentés par compagnies et pennonages ; leurs pennons ou officiers sont nommés par le consulat, d'accord avec le lieutenant du roi ; les citoyens sont exempts du ban et de l'arrière-ban pour les fiefs et seigneuries qu'ils peuvent posséder dans le royaume ; ils sont dispensés de loger les gens de guerre, ne paient ni redevances ni impôts pour les immeubles qu'ils ont soit à Lyon, soit ailleurs... Enfin, ils sont gouvernés par le droit romain, en tant que ce droit n'est en opposition ni avec les lois fondamentales de la monarchie ni avec les ordonnances des rois".
La ville avait cependant son mode de contribuer aux charges publiques. A chaque avénement, elle demandait confirmation de ses priviléges, ce qui lui était accordé à un prix plus ou moins élevé. Le consulat ou corps de ville, qui se composait du prévôt des marchands et des échevins, envoyait à Paris une députation municipale qui traitait, avec le nouveau roi, de la ferme des gabelles et des droits à payer pour l'introduction à Lyon des draps d'or et de soie fabriqués à l'étranger.
Si le trésor public était insuffisant à payer certaines dépenses, le roi empruntait à la ville de Lyon, et affectait au remboursement tantôt les revenus à venir de telle contrée voisine, tantôt une convention de péage ou d'impôts à prélever sur le péage des farines ou sur le vin vendu au cabaret.
Au XVe siècle, il y avait douze échevins présidés par un prévôt des marchands. Ils étaient électifs et portaient la robe de velours violet. Tous les ans il y avait élection de six conseillers et on ne pouvait réélire ceux sortis l'année précédente.
Encore au XIVe siècle, pour l'élection, on convoquait tous les citoyens à l'église Saint-Jacques, et là, bourgeois et ouvrier, chacun votait en toute liberté. Au XVe siècle, l'élection était faite par les notables ouvriers.
Mais la bourgeoisie était en réalité maîtresse. Chacun des soixante-douze métiers avait deux notables, nommés par le maire et par les échevins. Le procureur de la ville et le greffier étaient inamovibles, mais sans voix délibérative.
Le commandant des trente-six pennonages qui constituaient la force publique était présenté par les échevins et nommé par le roi.
Les foires furent à la fois le principal objet de la sollicitude du sénéchal, du consulat et du roi Louis XI.
Par ses lettres au parlement du 8 mars 1462, il frappa les foires de Genève qui ruinaient celles de Lyon en interdisant le transit des marchandises par ses Etats.
Il ordonna qu'au lieu des trois foires octroyées pour un temps limité, il y en eût quatre, pour être tenues perpétuellement durant quinze jours entiers, commençant la première le lundi de Quasimodo, la deuxième le 4 août, la troisième le 3 novembre, la quatrième le lundi après la fête des Rois.
Autorisation de s'y servir de tout or et de tout argent et de toutes les voies possibles d'échange : promesse aux marchands de pouvoir faire entrer et sortir leurs marchandises sous ce règne et les suivants : "Désirant de tout son pouvoir augmenter et meilleurer lesdites foires et attraire les marchands à icelles, il octroye de grâce spéciale aux échevins pouvoir et autorité d'élire et commettre aucun homme suffisant et idoine, toutes fois que besoin sera, pour empêcher qu'aucun agent de la force publique ne fasse aux marchands aucune vexation ni extorsion : afin que lesdicts commis les accordent amiablement ou qu'ils nomment pour arbitres chargés de les accommoder deux marchands non suspects ; enfin, que si ces derniers ne peuvent les mettre d'accord, il les renvoye devant le juge à qui il appartiendra d'en connoître".
Je ne sais si c'est à Plessis-lez-Tours, entre Olivier le Daim et Tristan l'Hermite que Louis XI a conçu de telles ordonnances. Si cela est, Olivier et Tristan étaient d'honnêtes conseillers, auxquels Casimir Delavigne aurait dû, par égard pour la vérité historique, épargner, ainsi qu'à leur maître, un coup de pied plus ridicule que tragique.
La bailli de Mâcon devenu sénéchal de Lyon avait le titre de juge conservateur. Il représentait la justice royale.
Tous devenaient égaux en matière de commerce. "Ce tribunal pouvait ordonner la contrainte par corps contre les débiteurs fugitifs ; les arrêts étaient exécutoires dans toute la France. Tout marchand pouvait faire actionner un étranger à Lyon même".
La juridiction des notables prud'hommes était plus prompte et à la disposition de tous. Le tribunal de conservation est devenu le tribunal de commerce.Nous parlerons plus loin de ce que Louis XI a fait pour l'industrie de la soie.
Mais ce n'est pas tout encore. Louis avait tout tenté pour propager en France l'art nouveau de l'imprimerie. Cesarius et Stoll, sortis de l'atelier d'Ulric Gering, vinrent fonder une imprimerie à Lyon. On signale aussi dans ce temps celle de Guillaume Leroy. Celui-ci sous les auspices d'un capitalisme zélé, nommé Barthélemy Buyer, éditait, le 16 septembre 1473, le Compendium in-4° du cardinal-diacre Lothaire, ouvrage qui ne tarda pas à suivre en 1476 le Légende dorée in-folio de la Vie des Saints.
On y travaillait pendant le séjour de Louis XI à Lyon.
Dès lors le commerce prend une grande extension.
Au XVIe siècle, les protestants s'emparent plusieurs fois de la ville. C'est une horrible histoire que celle des persécutions et des cruautés exercées par les deux partis.
Un hôpital très-ancien et une église sous le vocable de Notre-Dame de la Saônerie occupaient le fond de la place de la Douane.
La chapelle et la récluserie de Saint-Eloy se trouvaient là auprès de la Saône et obstruaient l'entrée de la place.
Lorsque les protestants s'emparèrent de Lyon, en 1562, le capitaine du Tenoyl occupait ce port et s'y défendit vigoureusement. Mais, obligé de capituler, il fut fait prisonnier et conduit au château de Pierre-Scize.
Les illustres banquiers florentins, les Médicis, avaient, dans une rue nommée de l'Angèle, une succursale de leur banque, en 1496. Le nom de la maison disparut en 1548, lorsque Henri II et Catherine de Médicis vinrent à Lyon. Ils se fussent sentis humiliés, étant de ligne royale, de trouver des parents qui gagnassent leur vie en travaillant.
Tout s'efface devant l'infâme boucherie de la Saint-Barthélemy.
Les portes de la ville furent fermées, par ordre de Mandelot, lieutenant du duc de Nemours, gouverneur ; puis, sous prétexte de protéger les protestants contre la fureur des catholiques, le misérable les fit mettre en prison, les livrant ainsi aux assassins qui se ruèrent sur leurs ennemis et les égorgèrent pêle-mêle. Mandelot s'était éloigné avec sa garde, pour laisser le champ libre aux meurtriers, et, pendant ce temps, trois cents malheureux, réfugiés à l'archevêché, tombaient sous les coups des bandits catholiques.
Le bourreau avait refusé de les aider.
On comprend que le levain de liberté qui fermentait dans le coeur des Lyonnais ne demandât qu'une occasion pour s'aigrir encore. Lyon, après l'assassinat du duc de Guise, s'allia nettement à la Ligue, et ne se soumit à Henri IV qu'en 1594.
Pour la récompenser de son dévouement, le Père du peuple, l'honnête Henri IV, lui enleva ses franchises et ses libertés civiques.
C'est pourquoi, sans doute, la statue de Henri IV décore la façade de l'Hôtel de Ville.
Le 12 septembre 1642, un lugubre cortége s'arrêtait sur la place des Terreaux, encombrée de populaire, et au milieu de laquelle se dressait un échafaud.
Un mauvais carrosse de louage fendait la foule que repoussaient les gardes...
Cinq-Mars descendit le premier : il était vêtu d'un habit couleur noisette, couvert de dentelles d'or, portant un chapeau retroussé à la catalane, des bas blancs bordés de dentelle, et un manteau d'écarlate.
Devant lui, de Thou, vêtu d'un habit de deuil.
Cinq-Mars monta le premier sur l'échafaud, chapeau en tête. Un garde voulut lui découvrir la tête, mais d'un mouvement brusque, Cinq-Mars enfonça la coiffure sur son front.
Il fit la révérence à toute l'assemblée, dit un récit du temps, ayant la main gauche sur le côté, avec la même grâce et la même démarche qu'il avait dans la chambre du roi.
Puis il se mit à genoux, embrassa le billot, pencha la tête dessus en demandant à l'exécuteur : - "Est-ce bien ainsi que je dois me mettre ?"
Il remit aux mains du jésuite qui l'accompagnait, une boîte contenant un portrait et le pria de le brûler. Il prit ensuite les ciseaux et se coupa la moustache. Il se tourna enfin vers le poteau et l'embrassa étroitement.
- "Frappe", dit-il au bourreau.
Et la tête, tranchée d'un seul coup, fit plusieurs bonds en tombant.
De Thou monta à son tour, le chapeau à la main, le manteau sur le bras. Celui-ci n'affecta pas de pose théâtrale. Il eut un mot profondément sincère. Montrant le corps de Cinq-Mars, gisant à ses pieds : - "Je suis homme, dit-il, je crains la mort, cet objet me trouble, je vous demande, par aumône, de quoi me bander la vue".
Puis il se fit lier au poteau.
Le bourreau frappa douze coups avant de séparer la tête du tronc.
Pauvre de Thou ! victime de l'amitié, il inspire à tous une profonde amitié. Mais Cinq-Mars était un coupable, et, si effrayante que soit la grande figure de Richelieu, c'est une faute que de lui reprocher cet acte de justice, qui punissait un traître vendant sa patrie à l'étranger.Pour donner au lecteur une idée de ce qu'était Lyon à cette époque, je ne crois pouvoir mieux faire que d'emprunter à un naïf voyageur du XVIIe siècle, Jouvin de Rochefort, les lignes qui suivent et qui datent de 1672 :
"Lyon, dit mon touriste inconnu, a de quoi se glorifier de tant de merveilles qui l'accompagnent, qu'elle peut estre seule une Florence la belle, une Naples la gentille et une Gênes la superbe, renfermant en elle ce que les trois autres ont de remarquables séparément. Son climat est doux, son assiette agréable, ses places magnifiques, ses palais somptueux et ses habitants lestes (sic), qui sont les parties qui composent la beauté d'une ville...
"Quand on en considère la situation, elle paraît bornée de deux hautes montagnes et arrosée de deux larges fleuves, entre lesquels se forme une vaste péninsule, où l'abbaye d'Ainay fait la pointe et le commencement, la montagne Saint-Sébastien, qui lui sert de boulevard et d'écran contre les vents du nord, qui poussent souvent la bise avec trop de violence".
Mon voyageur monte à Fourvières et se pâme devant le tableau. Il descend ensuite de ce haut lieu "où sont plusieurs belles maisons avec leurs jardinages, pour aller à Saint-Just qui est une chanoinie bien riche, auprès d'une porte de la ville du même nim, par où il faut sortir pour aller voir le Prieuré, Saint-Irénée et quelques antiquités des Romains".
"Les Minimes ont un très beau couvent proche l'église Saint-Just, au-dessous de laquelle est celle de Saint-Georges, qui relève du grand commandeur de la province d'Auvergne. Ce jeune homme (son guide) nous montra au bord de l'eau une maison qui lui appartenait, en laquelle il y avait dix-huit ménages, tous gens qui travaillaient à faire des étoffes de soye. Il me semble y avoir compté sept étages, sans les caves qui sont aussi habitées, d'où on peut juger la quantité de monde qu'il y a dans la ville de Lyon".
Par la porte Saint-Georges, au bord de la Saône, il arrive au faubourg de Vaise, qu'il écrit Vèze, "où est le fort chasteau de Pierre Ancise (Pierre Scize), qui correspond au boulevard Saint-Jean, qui est à l'autre bord de la rivière. Il y a garnison dans les deux, mais le château de Pierre Ancise est le plus merveilleux à voir, bien qu'il ne soit pas de grande étendue ; car il n'est que dessus l'échine d'une partie de rocher, qui en est voisin et d'autant plus fort qu'il est escarpé du côté de la rivière, qui lui lave le pied, et de l'autre défendu d'un large espace en façon de fossé du côté de la montagne".
"On y monte par plusieurs degrés taillés dans le roc, et ce qu'il y a de plus plaisant, c'est une grosse source qui sort du rocher dans le chasteau, où est un donjon couvert de quelques pièces de canon, qui tiennent en défense l'entrée de la rivière de Saône et de la porte de Vèze, où la seule grande rue de la Juiverie nous conduit à la belle église Saint-Paul qui est une grande paroisse et riche chanoinie".J'ai eu la curiosité de suivre pas à pas l'itinéraire de mon ancêtre, et dans cette rue de la Juiverie, occupée aujourd'hui par des tanneurs, j'ai découvert au fond d'une allée sordide et d'une cour non moins malpropre un véritable bijou architectural, oeuvre de Philibert Delorme, le célèbre Lyonnais né vers 1515.
Est-ce donc là une de ces oeuvres qui enthousiasmèrent le cardinal de Bellay au point de l'engager à entraîner Delorme à la cour de France ?
Au n° 11 de la rue Saint-Jean, j'ai eu la bonne fortune de découvrir un autre morceau remarquable. Hélas ! les Lyonnais se souviennent trop peu de ces vestiges du passé. Il nous appartient de les remettre en lumière.
Une petite rue menait alors au couvent des Capucins et des Carmes déchaussés "qui ont des jardins et la veüe sur toute la ville".
Le palais du gouverneur, M. le duc de Villeroy, était situé sur le bord de la Saône "avec une belle terrasse", et en avant se trouvait la place neuve "où il y a une fontaine, mais ce n'est pas merveille qu'il y ait des fontaines à Lyon, puisqu'elle est assez voisine des montagnes".
Les titres de Villeroy formaient une liste interminable : Camille de Neuville de Villeroy, archevesque et comte primat des Gaules, lieutenant général au gouvernement de Lyon et pays de Lyonnais, Forey et Beaujolais, ayant justice particulière sous titre d'officialité, etc.
Trois ponts traversaient alors la Saône, allant à Fourvières qui était la pente la plus importante de Lyon : le pont Saint-Vincent, en pierre ; le pont Saint-Georges en bois, qui aboutissait par la rue de la Barre à la place Louis-le-Grand (Bellecour), et le pont de bois de Sainte-Claire d'Ainay au quartier Saint-Georges.
Puisque nous avons prononcé le nom d'Ainay, rappelons qu'à cette époque c'était à ce point que se trouvait le confluent de la Saône et du Rhône. Au delà, s'étendait une île qu'on appelait l'île Mogniat.
Sous Louis XIV, il avait été question de réunir l'île à la péninsule : mais le propriétaire avait su toucher le coeur du très-grand roi par une petitesse assez plate pour être prise en considération. Il lui avait adressé le quatrain suivant :
Qu'est-ce pour toi, grand monarque des Gaules,
Qu'un peu de sable et de graviers ?
Que faire de mon île ? Il n'y croît que des saules,
Et tu n'aimes que des lauriers.Ce ne fut qu'en 1770 que Perrache (Antoine Michel), architecte et fils du sculpteur lyonnais auquel on doit le maître-autel de Saint-Nizier, conçut le plan véritablement digne d'une haute intelligence qui devait donner à la ville une importance plus grande encore. Conquérir d'immenses terrains à l'industrie était certes une magnifique pensée ; et plus méritoire fut l'oeuvre en raison des oppositions routinières que le bienfaiteur des Lyonnais eut à vaincre.
Au XVIIIe siècle, les étrangers qui venaient à Lyon logeaient aux environs de l'Arsenal et de Bellecour qui était déjà la promenade favorite.
"On y voit ordinairement la noblesse et tout le peuple qui se rendent par bandes sur ces quais qui sont très beaux : c'est où se tiennent des concerts, où se pratiquent toutes sortes d'honnestes galanteries, et où se voient mille beaux visages et mille personnes lestement vestues, sous les beaux ombrages de trois rangées d'arbres qui vont de bout en bout de cette place, où elles forment deux allées, dont une sert de mail, large de cinq cents pas. Autant qu'il y a de maisons qui l'environnent, ce sont autant de palais qui regardent une belle verdure au milieu de cette place si unie que de loin on la prendroit pour quelque tapis inventé par la mollesse turque".
Bravo, monsieur Jouvin de Rochefort. Voilà un vrai style et galant au dernier point.
Passant à la place des Terreaux, il déclare que ce qui donne tout le lustre à cette place, c'est le bâtiment majestueux de l'Hôtel de Ville.
"Quatre gros pavillons en font le dessin quant au dehors ; mais le dedans est quelque chose de plus parfait. Ce magnifique édifice efface la gloire de l'ouvrage d'Arthémise, à qui les sept merveilles que l'antiquité nous rend si fameuses pouvoient toutes le céder en ornement et en gentillesse, l'Amour en ayant été l'ingénieur".On ne s'attendait guère à voir l'amour en cette affaire.
De la place Bellecour aux Terreaux, c'était un dédale de rues dans lesquelles il n'était d'autre ligne à peu près droite que la rue Saint-Dominique aboutissant à la place Confort, aujourd'hui des Jacobins.
Mais les quartiers de rue Thomassion, de rue Tupin, de la Croisette, du Plâtre étaient à vrai dire un labyrinthe inextricable.
Certes si le bon Jouvin de Rochefort revenait à la vie et qu'il se trouvât subitement transporté place des Jacobins, il ne s'écrierait plus tristement : "Cette place m'a douloureusement ému, en ceci qu'elle n'est point tant belle que telles autres de la ville".
En vérité, pour qui étudie, de façon si superficielle que ce soit, les villes du passé et nos admirables cités d'aujourd'hui, il est impossible de se défendre d'un sentiment d'orgueil et de ne pas déclarer hautement que, si colomnié qu'il soit par les esprits chagrins et haineux du progrès, le XIXe siècle surpasse ses devanciers de toute la distance qui sépare l'intelligence du bien-être général des satisfactions égoïstes réservées aux seuls privilégiés.
Il est un homme dont je ne voudrais point passer le nom sous silence, quand je parle des embellissements de Lyon : c'est celui de M. Chatron, l'excellent architecte auquel on doit les magnifiques constructions de la place des Jacobins et qui a attaché son nom aux remarquables bâtiments de l'exposition. C'est faire oeuvre bonne et utile que de consacrer sa vie à transformer sa ville natale, et c'est à ce titre que je salue en passant l'homme qui peut-être a travaillé le plus activement à justifier ce titre de seconde ville de France que Lyon mérite chaque jour davantage.Je me suis longuement étendu sur le Lyon du XVIIIe siècle ; il me faut maintenant me hâter de retracer ses annales récentes. Mais ne sont-elles pas dans la mémoire de tous ? Le siége de Lyon par l'armée de la Convention a été cent fois décrit, et trop souvent on eut recours à cette arme pour détacher les Lyonnais de leurs convictions républicaines.
Mais peuvent-ils oublier que les émigrés et les ennemis de la France avaient tenté de faire de Lyon et du Midi une nouvelle Vendée, que les Anglais étaient attendus à Marseille comme en Bretagne ? Il fallait sauver le pays sous la crise la plus effroyable qu'il ait traversée. Le crime des traîtres était grand, la répression fut terrible. Mais la France était restée debout.
La véritable situation de Lyon au commencement du XIXe siècle est nettement présentée par ces quelques lignes, empruntées au grand historien national, M. Thiers :
"Le comte d'Artois s'était rendu à Lyon après la première restauration".
"Cette grande ville n'était pas une de celles où la situation était la moins compliquée. A côté d'anciens royalistes, pleins du souvenir du siége de 1793, détestant la Révolution et ses oeuvres, et réunis avec exaltation sous leur ancien commandant, M. de Précy, on voyait une riche classe de commerçants manufacturiers, étrangers par leur âge aux souvenirs de 1793... La guerre maritime qui avait ruiné Nantes, Bordeaux, Marseille avait au contraire enrichi Lyon. Elle était devenue le centre d'affaires le plus actif et le plus vaste... La possession de l'Italie, la faculté d'en tirer les soies brutes à bas prix, sa facilité de porter ses riches étoffes à tout le continent étaient des avantages que Lyon avait fort appréciés et qui diminuaient à vue d'oeil depuis que les mers étaient ouvertes et que les Anglais, aussi maîtres que les Autrichiens en Italie, faisaient renchérir les soies brutes en les achetant pour les travailler eux-mêmes. A ces déplaisirs, il faut ajouter les exactions commises par les Autrichiens (qui avaient occupé la ville rendue par Augereau), et on comprendra les motifs divers qui rendaient froide au moins, sinon hostile à la cause royale, la classe des commerçants lyonnais... Le peuple imitant ces divisions était partagé. Une portion peu nombreuse, mais ardente, s'était jointe aux royalistes. Le reste suivait en masse le parti contraire. Les royalistes se réunissaient dans un café et en sortaient quelquefois pour aller provoquer leurs adversaires... C'est au milieu de ce foyer brûlant que le comte d'Artois vint jeter de nouvelles matières incendiaires".
Le comte d'Artois disait très nettement qu'on avait beaucoup trop concédé à la Révolution. Il demandait s'il ne serait pas possible de rendre les biens nationaux...
Aussi Lyon fut-elle une des premières villes à acclamer la chute des Bourbons, lors du retour de l'île d'Elbe.Lasse d'agitation, Lyon employa les quinze années suivantes à relever son commerce qui prit une immense extension. Nous arrivons aux douloureuses années 1831-1834.
Loin de nous la pensée de raviver des souvenirs pénibles. Cependant, au chapitre suivant qui traite spécialement de l'industrie et des ouvriers, nous expliquerons ce qu'étaient ces insurrections et peut-être parviendrons-nous à faire comprendre que le seul moyen d'en prévenir le retour, c'est de ne pas imiter ces trembleurs ridicules et dangereux qui, au seul mot de "question sociale", jettent les hauts cris et demandent la question préalable.
Il y a une question sociale, c'est-à-dire une étude naissant de rapports à établir entre le travailleur et le négociant, entre le fabricant premier et l'intermédiaire. Devine ou je te dévore, disait le sphinx. Au lieu de railler l'énigme en déniant la possibilité d'une solution, les hommes de bon vouloir doivent redoubler d'efforts pour répondre au sphinx et pour frayer au progrès réel une route large et libre.
Qu'on ne s'y trompe pas, c'est de la gêne économique que procède à Lyon tout mouvement révolutionnaire, et toutes les poignes de tous les Ducros du monde ne prévaudront pas contre la marche inflexible du progrès : tant que le caprice ou le mauvais vouloir tenteront de l'enrayer, il y aura résistance, lutte, explosion.
L'Empire haïssait Lyon : cependant le coup d'Etat de Décembre n'avait soulevé aucune résistance sérieuse. Mais la proscription n'en fut pas moins exercée dans le département sur une vaste échelle : mauvaise précaution. Ce n'était pas assez, Lyon se taisait, mais il fallait lui ôter jusqu'au pouvoir de parler.
La municipalité élue fut supprimée d'un trait de plume. Et cet odieux régime de défiance et d'oppression devait durer jusqu'en septembre 1870. Certes, à en croire les officieux, la populace seule tenait à ses franchises et songeait à les revendiquer. C'est là un de ces mensonges auxquels nous ont habitués les feuilles impériales. C'est au contraire dans les rangs de la bourgeoisie que grandissent chaque année davantage l'antipathie profonde et le mépris qu'inspirait l'Empire. En vain, pour donner le change, bouleversait-on la ville, et d'une cité de travail et de commerce tendait-on à faire une seconde "auberge du monde".Vint Sedan : Lyon proclama la République avant Paris.
Les événements qui suivirent appartiennent de trop près à l'histoire contemporaine pour que nous ne nous y arrêtions longuement. Mais nous signalons les excellentes tendances de l'esprit lyonnais, qui réagit contre le cléricalisme, par tous les moyens en son pouvoir, qui réclame la suppression des octrois, la laïcité de l'enseignement et fait preuve, en toute circonstance, de cette netteté de vues qui, depuis le moyen âge, n'a cessé d'être le propre de sa population intelligente et active.
Jetons en passant quelques fleurs sur l'honorable Ducros, dont le nom restera légendaire de Vaise à la Guillotière et de Perrache aux Brotteaux.
Il serait injuste de méconnaître les immenses services que nous a rendus cet intransigeant de l'ordre moral. Grâce à lui, les esprits les plus prévenus ont éprouvé pour le régime du 24 mai la répulsion qu'il méritait, ses persécutions sottes et taquines ont contribué à l'établissement définitif de la République, à la formation du grand parti libéral. Et ce n'est pas là un mérite pour l'ami des Cocos et autres personnages qui semblent appartenir à quelque création fantaisiste d'un romancier.
En réglementant les enterrements civils et en attendant aux droits les plus sacrés de la liberté de conscience, le préfet Ducros a porté aux cléricaux un coup dont ils auront peine à se relever. Il laisse des monuments administratifs à la fois "odieux et burlesques bien faits pour inspirer des doutes sur la parfaite santé d'esprit de leur auteur".
Aujourd'hui, les dernières élections ont prouvé que Lyon était toujours la ville du bon sens et de la liberté.
Les Ducros passent et la vérité reste.
Une nouvelle ère de progrès a commencé. Les passions s'apaisent et la confiance renait. Désormais, dégagée de ses préoccupations douloureuses, la grande cité marche d'un pas plus rapide et plus sûr à la tête de l'industrie française dont elle porte si haut et si noblement le drapeau.La soie
"L'antiquité des origines est, pour les industries comme pour les familles, un titre qu'il leur est permis de faire valoir ; si pour celles-ci elle n'est souvent qu'un prétexte à s'enorgueillir, celles-là ont le droit de la revendiquer pour mieux établir la solidité de leur constitution, expliquer leur croissance dans le passé et se fortifier dans l'espoir que leur prospérité sera durable".
Ainsi s'exprime un rapport, récemment publié par ordre de la Chambre de commerce de Lyon, et auquel nous emprunterons la plupart des intéressants détails qui vont suivre.
S'il était donné à nos élégantes de voir ces petites chenilles noires, s'échappant de leur oeuf, ayant à peine une ligne de longueur, elles auraient peine à reconnaître en cet animal d'aspect répugnant le premier fabricateur de ces étoffes admirables, dont les maris connaissent, hélas ! trop bien le prix.
A peine est-il né qu'il est malade. La nature semble avoir mesuré les douleurs de l'effort à la grandeur de la tâche. Quatre crises viennent torturer le pauvre animal, qui reste chaque fois, pendant vingt-quatre heures, entre la vie et la mort. Mais s'il résiste, le voilà qui se jette avec une voracité singulière sur les feuilles de mûrier. A sa quatrième maladie, il a environ deux pouces de longueur ; sa couleur est alors d'un blanc grisâtre... et il mange, il mange toujours. Quand ils sont réunis par milliers, on a comparé le bruit de leurs mandibules au crépitement de la grèle.
Mais tout à coup l'heure sonne où il doit accomplir sa mission : de l'état de ver il va passer à l'état de papillon. Mais c'est pendant cette métamorphose que s'opère le travail le plus curieux qu'il nous ait été donné de contempler.
L'animal ne mange plus : il construit son tombeau, mais un tombeau de roi d'où il ressuscitera papillon.
Voici comment le fabrique le ver à soie : il monte sur une branche de mûrier et y choisit sa place ; il commence à placer en tous sens des fils très-déliés ; il s'enveloppe, et alors le travail prend une forme de plus en plus régulière. Il dispose le fil ténu et gommeux qui sort continuellement de sa bouche, de manière à se renfermer dans une coque oblongue et ovale ayant environ un pouce de longueur.
C'est le cocon.
Pendant les deux premiers jours, on peut apercevoir l'insecte à travers ce tissu qu'il forme lui-même ; ensuite il devient invisible sous le réseau toujours plus serré... Alors il devient chrysalide, sous forme d'une fève grisâtre. Il reste immobile jusqu'au jour où, perçant le cocon, il s'échappe cette fois sous forme de papillon.
Ces fils qui constituent le précieux cocon, c'est la soie. Et voilà que sur ce fil, d'une ténuité extrême, l'industrie humaine a étayé un édifice d'une énorme richesse. Cet infiniment petit de la création va devenir la source d'une prospérité toujours grandissante : pour lui et par lui on construira des villes immenses ; pour lui et par lui les hommes s'enrichiront et les femmes se perdront.
Le cocon, c'est la boîte légendaire de Pandore d'où s'échappent et les biens et les maux. Et pendant que des milliers d'ouvriers se courbent sur leurs métiers, que les gros négociants alignent en inventaire des colonnes interminables de chiffres, que les femmes font craquer les plis épais de leurs robes orgueilleuses, le papillon, à ailes courtes et blanches, donne ses oeufs et meurt.
Le véritable fondateur de l'industrie de la soie en France, est un homme auquel l'histoire commence à rendre aujourd'hui la justice qui lui est due, en dépit des calomnies dont les adversaires de la liberté religieuse avaient souillé sa mémoire, Louis XI, auquel la France doit et son existence propre et sa prospérité.
"Dès le XVe siècle, dit M. Legeay dans son excellente Etude sur Louis XI, on travaillait la soie en France ; toutefois, l'Italie surtout avait le monopole de cette production ; on évalue à 500.000 écus l'argent qui sortait annuellement de France pour l'achat des draps d'or et de soie, lorsque le roi songea à changer cet état de choses. L'initiative individuelle ne pouvait produire que des essais, et il y avait loin de ces tentatives isolées à la complète organisation d'un mode de fabrication si compliqué. Pour le succès, il fallait un patronage ferme et soutenu. Par lettres patentes du 23 mai 1466, le roi établit à Lyon un centre privilégié pour la fabrication de ces précieuses étoffes".
Il enjoint au sénéchal de Lyon et aux élus sur le fait des aides "de donner ordre que l'art de faire drap d'or et de soie soit introduit dans la ville de Lyon, où déjà il en est quelque commencement, de faire venir audit lieu maîtres, ouvriers appareilleurs et autres expérimentés tant au fait de l'ouvrage de ladite soie, que ès teintures et autres choses à ce propos".
De plus, pour que ces divers ouvriers soient disposés à venir résider à Lyon, il leur octroie d'y demeurer quittes de toutes tailles et impositions, ainsi que de l'impôt de douze deniers par livre pour tous draps d'or et de soie qui seront faits et de ce qui est exigé pour première vente.
Ainsi non-seulement le roi appelle d'Italie à Lyon des ouvriers tisseurs en soie et d'habiles teinturiers pour la complète production de ces tissus, dès lors si recherchés, mais il les y installe avec leurs métiers et leurs accessoires. N'avaient-ils pas là, comme à souhait, pour l'opération indispensable du lavage des soies, les eaux si belles du Rhône et de la Saône ? Louis XI fit avec bon espoir une grande partie des frais nécessaires à cette installation, qui devait avoir de si féconds résultats. Comme moyen subsidiaire, il ordonna la levée d'une somme annuelle de deux cent mille livres tournois sur les habitants : sacrifice momentané dont ils devaient retirer un immense profit. Toutefois, des représentations lui ayant été faites au sujet d'une dette contractée pour son service envers la ville, il fit surseoir au paiement de l'impôt jusqu'au moment où les trois mille livres dues par l'Etat furent soldées.
Bientôt la fabrique de Lyon prit une grande importance : car le roi demanda trois députés à la ville, dont un de l'industrie, pour participer aux délibérations des Etats généraux de 1548. En même temps, il ordonna de nombreuses plantations de mûriers auprès de Lyon, en Dauphiné et, plus tard, en Touraine.
La Provence ne lui appartenait pas encore.
"Il était singulier, ajoute M. Legeay, à une époque où on ne rêvait que tournois, prix d'armes et luttes chevaleresques, de voir un roi si sincèrement préoccupé de tout ce qui pouvait donner au pays de France, pour l'avenir, prospérité, gloire et richesse. Il devinait par intuition les vrais sources de la fortune et du bien-être du crédit, de la liberté sagement réglée des échanges et de plusieurs autres innovations dont son génie prit l'initiative".Et cependant Louis XIV, qui a failli ruiner Lyon, a sa statue place Bellecour...
Tandis que Louis XI, créateur de la cité de travail, est oublié et dédaigné. Faute à réparer. Qu'on y songe.
Après Louis XI, François Ier. A celui-ci ce sera dans l'histoire une excuse que d'avoir protégé et développé l'industrie française. Il est vrai qu'il obéissait non plus à une intuition de génie, mais uniquement à une pensée de manoeuvre militaire. Il voulait ruiner Gênes.
Aux termes de la Charte qu'il donna en 1536, les ouvriers qui viendront se fixer à Lyon pour faire des draps d'or et d'argent, velours, satin, damas, soie, auront la facilité d'acquérir dans le royaume tels biens, meubles et immeubles que bon leur semble, tester et succéder comme s'ils étaient natifs du royaume, et ce sans prendre lettre de naturalisation ni d'aubaine.
En 1540, Lyon était déclaré l'entrepôt unique de toutes les soies étrangères qui entraient en France. Les marchands de Paris, de Tours, de Nîmes, etc., demeurèrent astreints à les faire passer par Lyon, qu'elles vinssent de Marseille ou d'Italie par le Pont-de-Beauvoisin.
Déjà en 1564, sous Henri II, le nombre de maîtres ouvriers, d'après un règlement présenté à sa sanction, s'élevait à 12.000. Lorsqu'il fit son entrée solennelle à Lyon, on comptait dans le cortége 459 tissortiers, 446 teinturiers, tous habillés des étoffes les plus riches et "merveilleusement beaux à voir", dit l'auteur de la Chronique imprimée par le Consulat.
Il y avait hiérarchie entre les tissus : le satin venait après les draps d'or et d'argent et les velours dans les cérémonies où figurait le Parlement, le président était habillé de velours, les conseillers et maîtres, de satin, le damas était laissé aux greffiers et le taffetas aux huissiers.
On lit dans un mémoire du XVIe siècle : "Il n'y a ville en ce royaume à qui Dieu ait imparty autant de grâce qu'à la ville de Lyon pour faire vivement réussir la soye en toute sorte de coleurs".
Le travail prit une telle extension que pour loger les ouvriers, il fallut ajouter de nouveaux étages aux maisons.Puis venaient les inventions nouvelles.
En 1608, Dangon invente une étoffe tramée laine et fil, mélangée d'or et d'argent ; à la même époque, Antoine Bourgot invente la guimparie en gazes, crèpes, toiles d'or et d'argent.
Puis c'est la Ferrandine, puis le lustrage des taffetas blancs.
La fabrique des bas de soie est importée d'Angleterre par James Fournier. Charlier, un simple ouvrier, imagine une étoffe qui imite le point de tapisserie des Gobelins. Le père Sébastien perfectionne les procédés d'affinage et d'étirage de l'or.
La France ne demande plus rien à l'Italie et exporte pour 40 millions de soie.
Mais voici venir la révocation de l'Edit de Nantes, mesure aussi cruelle qu'impolitique, promulguée le 15 avril 1698. Devant les persécutions, les religionnaires émigrent, les grandes manufactures se ferment, les maisons de commerce s'écroulent, des cantons se dépeuplent, des villes, hier encore pleines d'animation, semblent des déserts, et la plus intelligente, la plus laborieuse partie de la population va porter à l'étranger les secrets de notre industrie.
De 10.000 métiers, Lyon tombe à 2.000. Ce fut un épouvantement dans cette ville de probité et de travail. La stupeur dura plus d'un demi-siècle. En 1739, le chiffre des métiers n'était encore remonté qu'à 7.500. Et ce n'est qu'en 1753, qu'est atteint de nouveau le nombre de 10.000.
Mais dès lors, le mouvement ne s'arrête plus. En 1787, 18.000 métiers occupent près de 80.000 personnes et consomment 10 à 12.000 quintaux de soie, dont un tiers en soies du pays.
Lyon mérite encore une fois le nom de Grande Fabrique qui lui était acquis depuis longtemps.
La Révolution passe, et avec elle une nouvelle crise. La réaction veut se faire de Lyon un rempart contre l'esprit nouveau, le centre d'une Vendée méridionale. La Convention, soucieuse de l'intégrité de la République, se voit contrainte de frapper Lyon.
Mais c'était la dernière épreuve, et au prix de ses souffrances suprêmes, Lyon avait acquis avec toute la France les droits imprescriptibles qui seuls constituent les nations.
"La disparition des classes privilégiées, dit le rapport déjà cité, la division des fortunes, le nivellement des conditions, l'avénement du grand nombre à l'aisance comme à l'égalité politique, la tendance démocratique en un mot, tout cela appelle de soi graduellement la transformation de la production industrielle. Il s'agira moins maintenant de créer des produits somptueux, remarquables par leur richesse, que d'arriver à les mettre à la portée de tous, s'il est possible. La fabrique lyonaise, avec une souplesse qui ne laisse pas d'étonner de la part d'une industrie de luxe, se pliera vite à cette direction nouvelle : elle saura approprier sa fabrication aux nécessités modernes".C'est alors que paraît Jacquard, dont la machine, en allégeant le travail de l'ouvrier, en modifiant les conditions de logement et de vie mutuelle, va contribuer à son amélioration morale.
Jacquard est né à Lyon, le 7 juillet 1752. Son père était maître ouvrier en étoffes d'or, d'argent et de soie, et sa mère était liseuse de dessins. La vie de Jacquard fut pénible et agitée. Il n'avait pas voulu continuer la profession de son père, et il prit d'abord celle de relieur de livres qu'il changea bientôt contre celle de fabricant de chapeaux de paille.
Après le siége de 1793, il alla rejoindre son fils dans les rangs de l'armée républicaine, et, le fusil en main, la cocarde tricolore au chapeau, il marcha vers la frontière. Mais peu de temps après ce fils tombait frappé d'une balle.
Jacquard revint à Lyon.
"Déjà en 1790, dit Larousse, Jacquard avait conçu l'idée du métier, qui supprimait l'opération du tirage. Mais le manque d'argent l'empêcha alors de réaliser son invention. Deux ans plus tard, la Science du bonhomme Richard (Franklin) lui tomba entre les mains, et les sages préceptes du patriote américain produisirent sur son esprit une vive impression, dont il rendait ainsi compte dans une lettre publiée par M. Leynadier :
"J'étais sobre, je devins tempérant ; j'étais laborieux, je devins infatigable ; j'étais bienveillant, je devins juste ; j'étais tolérant, je devins patient ; j'étais intelligent, j'essayai de devenir savant".
Ces quelques lignes sont un véritable chef-d'oeuvre d'analogie psychologique, et je ne sache rien qui caractérise mieux cet esprit lucide, apte à embrasser d'un seul coup d'oeil les diverses phases du problème et de les résoudre.
Quel était donc le problème ?
Comme il est facile de le comprendre, les premiers tissus ne furent que des nattes et des tresses grossières, que l'on rapprochait à côté les unes des autres pour en obtenir de plus larges bandes. Puis on fabriquait à la main, sans métier, des toiles étroites qui furent encore réunies côte à côte et cousues ensemble. Enfin on fabriqua les tissus les plus simples de dimensions plus larges, au moyen de quelques métiers sans complication.
A mesure que cet art devenait plus positif et que les connaissances relatives au tissage se popularisaient, on essaya d'imiter sur ces toiles des dessins géométriques, des lignes, des cercles, des parallélogrammes, puis ensuite des formes naturelles, comme celles des tiges, des racines, des branches, des feuilles, des fleurs, des paysages et des portraits.
Les premiers métiers étaient simples comme les étoffes qu'ils devaient former : la mécanique, science alors douteuse, n'était que peu ou point appliquée aux arts manufacturiers, mais ces tentatives d'imitation firent naître des complications progressives, et le nombre des lames ou lisses fut augmenté.
On appelle lisses des assemblages de mailles de même espèce qui servent à hausser ou à baisser à volonté, au moment du tissage, les fils de chaîne pour livrer passage à la navette entre eux et opérer leur revirement sur celui de la trame.
Un inconnu inventa les métiers à semple ; mais ils étaient composés d'un si grand nombre de cordages, que pour obtenir un tissu quelque peu compliqué on était obligé d'employer deux et quelquefois trois personnes, ce qui ralentissait l'exécution et augmentait la main-d'oeuvre.
Déjà on pressentait que l'action mécanique pouvait être substituée au travail manuel. Le célèbre Vaucanson fut invité par le gouverneur à se rendre à Lyon, pour étudier l'état de cette question qui avait soulevé entre les fabricants et les ouvriers de vives discussions. Les ouvriers réclamaient pour leur travail - d'ailleurs fatigant et compliqué - une rémunération qui paralysait le commerce des étoffes de soie. Ils fondaient leurs protestations sur l'intelligence peu commune qui était, selon eux, nécessaire pour le tissage ouvré.
Vaucanson s'éleva contre cette dernière affirmation, et comme preuve à l'appui de son dire, il demanda un échantillon du tissu qu'on lui dit être le plus difficile à fabriquer : il en analysa le croisement, et quelque temps après, il montra une machine au moyen de laquelle un âne exécutait, avec toute la perfection désirable, le tissu demandé.
C'était fort spirituel, mais peu pratique : car la machine nécessitait sans cesse de telles réparations que l'âne - tant travailleur qu'il fût - eût été promptement contraint de s'arrêter et qu'il eût fallu avoir recours aux plus savants mécaniciens pour remettre la machine en état.
Après Vaucanson, nouveaux efforts de Falcon, qui n'aboutit encore qu'à la construction d'une machine infiniment trop compliquée.
Comme la précédente, elle dut être reléguée au Conservatoire.
Avant la paix d'Amiens, la Société royale de Londres avait proposé un prix considérable pour l'inventeur d'un procédé mécanique applicable à la confection des filets. Un extrait de ce programme, traduit par un journal français, tombait sous les yeux de Jacquard, dans une réunion d'amis. Quelques jours après ; il jetait un filet sur la table en s'écriant : "Voilà la difficulté résolue".
Ici se place un trait bien caractéristique de l'intelligence des fonctionnaires. Carnot entend parler de Jacquard et mande au préfet de lui envoyer le mécanicien à Paris, le plus tôt possible. Le digne porte-palmes - digne de s'appeler Ducros - flaire une conspiration, fait arrêter Jacquard et l'expédie à Paris sous escorte de gendarmes.
A son arrivée, sa machine fut examinée au Conservatoire des Arts et Métiers ; puis Carnot lui dit brusquement : - "Est-ce vous qui prétendez faire ce que Dieu lui-même ne ferait pas, un noeud sur une corde tendue ?"
C'est alors que le Lyonnais se mit à l'oeuvre. Et bientôt il découvrit le principe unique qui domine toutes les combinaisons du tissage.Ce principe, quel est-il ? Nous allons tenter de l'expliquer aux plus inexpérimentés.
Tout tissu se compose de fils croisés, passant les uns au-dessus des autres. Un jeu de fils tendus horizontalement se nomme chaîne, un autre jeu tendu verticalement se nomme trame. Il s'agit de faire passer les fils de trame entre les fils de chaîne, de telle façon que les fils de trame paraissant à l'intérieur, c'est-à-dire à l'endroit de l'étoffe, forment le dessin.
Or, il est facile de comprendre qu'il est nécessaire de lever les fils de chaîne de façon à ce que la navette passe dessous, et de lever soit tous les fils pairs ou impairs pour les étoffes unies, soit un, deux, ou plusieurs de ces fils, pour les dessins compliqués.
Le jeu de la navette passant sous le fil de trame se nomme une duite.
A chaque duite - à chaque jeu de navette - l'ordre des fils à soulever peut changer. Autrefois, pendant que l'ouvrier lançait la navette, des aides - appelés tireurs de lacs - devaient soulever les fils au moyen de ficelles, manoeuvre très-fatigante en raison du poids des fils, tendus par des plombs. De plus, l'attention soutenue, qui était indispensable, faisait souvent défaut, d'où des erreurs et des pertes de temps considérables.
Ceci compris, décrivons le modèle Jacquard, dont le but est d'opérer le soulèvement des fils mécaniquement.
Les fils qui passent entre les interstices de la planche à collets, m, o, nommés arcades, correspondent à tous les fils de chaîne qui doivent être soulevés en même temps pour donner passage à des fils de trame de même couleur.
Ces fils sont attachés, à leur extrémité supérieure, à des aiguilles p, p, p, qui elles-mêmes sont accrochées à la lisse EF. Donc, si l'aiguille p soulève la lisse, elle soulèvera en même temps le fil de chaîne.
Ces aiguilles p, p sont accrochées, à leur partie supérieure, à des lames légèrement inclinées, 1, 2, 3, 4, de telle sorte que le moindre effort dans la direction BA suffit à les décrocher.
Chacune de ces aiguilles p est engagée dans un oeil ovale m, pratiqué dans le parcours d'aiguilles horizontales 1, 2, 3, 4, etc... dont le moindre mouvement agit nécessairement sur elles. Si les aiguilles horizontales sont repoussées en arrière, c'est-à-dire en sens inverse de la flèche x (fig. 1), le crochet de l'aiguille verticale quittera la lame inclinée. Si alors on soulève la traverse AB, seules les aiguilles p, dont le crochet est encore engagé dans la lame cd, seront entraînées par la traverse, et soulèveront les fils correspondants ou arcades, qui passent en no et qui soulèveront à leur tour les fils de trame sous lesquels devra passer la navette.
Ce qu'il fallait obtenir, c'était le mouvement automatique des aiguilles horizontales m.
Or, voici ce qu'imagina Jacquard. En H, on place un carton (fig. 2) percé de trous qui correspondent aux aiguilles m. Ces aiguilles sont garnies, à leur extrémité C d'un ressort à boudin qui les pousse dans le sens de la flèche x.
Faisons passer le carton devant les aiguilles. Toutes les fois que la surface du carton sera pleine, les aiguilles seront repoussées vers C, mais dès qu'elles se trouveront en face d'un trou, leur extrémité y entrera par la détente du ressort, d'où un double mouvement de va-et-vient qui se communique aux aiguilles verticales, les accroche aux lames ou les rend libres. Et, à chaque jeu du carton, le mouvement de la bande AB, soulevée, soulève en même temps les aiguilles restées accrochées, et livre passage à la navette sous les fils levés.
Le carton, formant une sorte de chaîne sans fin IJ, présente successivement les trous qui correspondent au dessin à former sur l'étoffe. Et, par un simple jeu de pédale, l'ouvrier soulève la planchette AB, et communique aux cartons, fixés sur un prisme G, un mouvement de rotation qui lui permet de travailler sans interruption.
Quelles qu'aient été les modifications apportées depuis au métier Jacquard, le principe est resté inattaquable : et les progrès réalisés par cet homme de bien ont été la source d'une nouvelle fortune pour ses compatriotes.
Sous le premier Empire, les métiers s'élevaient au nombre de 12.000 ; après la paix, 20.000 ; de 1825 à 1827, 27.000 ; en 1837, 40.000 ; en 1848, 50.000.
En 1807, la condition des soies recevait 362.557 kilogrammes ; en 1864, ce chiffre s'est élevé à 3.500.000 kilogrammes.
Aujourd'hui, la fabrique lyonnaise fait battre 120.000 métiers : quatre cents maisons de fabrique coopèrent à la production, et le chiffre annuel de plusieurs d'entre elles atteint 10, 15 et 20 millions.
Dans le tableau officiel du commerce extérieur de la France, elle représente plus d'un milliard !
Une statue a été élevée à Jacquard sur la place Sathonay.
Je la voudrais voir place des Capucins, au milieu même de cette cité de négoce et de travail qui commence à la rue Puits-Gaillot pour se prolonger jusqu'à la Croix-Rousse, et qui lui doit sa vie intense et son agitation sans repos...III
Lyon qui travaille
Si d'aventure votre bonne étoile vous conduit en touriste à Lyon et que vous soyez blasé sur les points de vue pittoresques, les phrases des ciceroni et les banalités monumentales, je vais vous donner un bon conseil.
Vous êtes logé - je n'en veux pas douter - à l'hôtel Collet, où vous avez été accueilli comme un hôte attendu ; vous y avez trouvé politesse, confort et, ma foi ! tarif proportionné à vos moyens. Vous avez admiré les élégances de la salle à manger, les décorations de M. Chenu, les plafonds de Guichard, salué le nom de M. Chatron, l'architecte qui a restauré ce temple de l'hospitalité, - style noble, - dégusté un excellent repas. Voilà qui est fait. Au moment de vous mettre au lit, demandez à votre hôte de vous indiquer la rue Puits-Gaillot, et de vous éveiller à cinq heures du matin.
Soyez tranquille. On sera exact. Hommes d'affaires, artistes, indigènes de tous pays ont passé par là, et il n'y a pas d'exemple qu'une seule fois le cri légendaire : - "Monsieur, il est cinq heures !" n'ait pas résonné à l'heure dite.
Donc, sur pied.
Comme vous êtes en plein centre, rue de Lyon, vous n'avez que quelques pas à faire pour atteindre la place de la Comédie, et vous allez vous poster, comme un observateur consciencieux, au pied de la montée du Griffon...
De toutes les rues voisines, des hommes sortent à pas pressés. N'ayez crainte. Malgré l'heure matinale, ces personnages, estompés par les premiers reflets de l'aube, n'ont aucun caractère mystérieux. L'aurore ne les arrache pas à quelque sabbat fantastique, mais bien aux douceurs du lit et du far niente.Si vous êtes physionomiste, tâchez de reconnaître les types des diverses catégories que je vais vous indiquer.
D'abord, en petit nombre, les patrons des grandes maisons de soierie.
Ceux-là sont calmes, solennels. Le patron qui se lève à cinq heures du matin ne peut être précisément un flâneur. C'est un bûcheur réel qui ne se fie à personne et ne croit qu'en lui-même.
Sans doute, penserez-vous, il a sa fortune à faire, et non faite. Erreur ! Il a le feu sacré du négoce, il l'aura toute sa vie ; de plus, dans ce travail de soie, il y a une sorte de fièvre artistique qui, chez beaucoup, devient passion. J'ai souvent rencontré, montant à petits pas pressés la rue du Griffon, un des hommes dont la signature vaut plusieurs millions.
- Cher Monsieur, me disait-il en ôtant son chapeau pour laisser passer dans ses cheveux blancs le souffle frais du matin, vous ne comprendrez jamais ce que c'est que notre métier, ainsi que vous désignez presque dédaigneusement nos occupations. Voyez-vous, il faut être né, avoir vécu là dedans... Quand j'avais quinze ans, je faisais déjà ma pratique...
- Qu'est-ce que la pratique ?
- C'est notre stage, à nous. Chez tout bon négociant, il y a l'ouvrier, le tisseur, le canut, si vous voulez, quoique maintenant, je ne sais pas trop pourquoi, ce mot soit pris en mauvaise part par ceux même qui y ont droit... Oui, droit ! je maintiens le mot. Je suis canut de naissance, d'éducation, de volonté... et à quinze ans, j'étais apprenti, je travaillais mes dix à douze heures par jour. Pourtant mon père était millionnaire ; mais il avait la passion de la soie, et il voulait que je l'eusse à mon tour... Interrogez les tisseurs, ils sont amoureux de leur Jacquard et caressent la navette comme si cétait la main potelée d'une femme... Quand j'ai su tisser mécaniquement, alors mon père m'a envoyé chez un maître apprendre la théorie. Les bons maîtres ne sont pas nombreux, et la soie est une Isis qui ne livre pas ses mystères aux profanes. Quand je faisais ma théorie, j'avais des éblouissements : je rêvais des ensoleillements d'or, d'argent, d'ineffables nuances se fondant en un prisme radieux... C'est notre poésie de jeunesse, à nous autres... Vous devez avoir fait de mauvais vers à quinze ans. Mais avouez qu'en les écrivant vous vous sentiez bien heureux.
- Et maintenant, lui demandai-je, pourquoi ne pas vous reposer ?
- Me reposer !... Mais croyez-vous que ce soit une fatigue pour moi que cette course matinale ? Voilà trente ans que je la fais, et je crois n'y avoir pas manqué huit jours. Quand ma femme était sur le point d'accoucher, je lui disais : "Tu sais que la nouvelle armure sera essayée demain matin". Elle m'a compris : l'enfant est né à trois heures du matin ; à cinq heures et demie j'étais chez l'ouvrier, et je vérifiais le travail de cette armure qui m'a valu plus de deux cent mille francs de bénéfices...
On appelle armure (je dois cette explication à mes lecteurs) le carton percé de trous dont la disposition forme les dessins, les originaux.
Et ainsi, depuis trente ans, mon interlocuteur allait chaque matin dans plus de vingt maisons surveiller les métiers, activer le travail, vérifier l'ouvrage en cours, donner des conseils, rectifier une disposition mal prise. Mais aussi c'était pour lui une véritable joie quand la pensée du dessinateur qui avait travaillé sous sa direction rendait au métier. C'était un orgueil d'artiste, et cette jouissance lui tenait lieu de toute autre.Mais tous les chefs de maison ne sont pas tels : le plus souvent ce sont les intéressés qui montent à la Croix-Rousse pour cette inspection quotidienne.
Ceux-là sont plus hâtifs, plus inquiets. Ils ont en quelque sorte une double responsabilité. Aussi, malgré eux, sont-ils généralement moins bienveillants avec l'ouvrier, plus brusques dans leurs rectifications, plus absolus dans leurs allures.
Nous voici chez l'ouvrier, chez le tisseur.
Le métier est installé en face de la haute fenêtre d'où la vue plonge sur le Lyon d'en bas. Rien de net, de propre, comme le métier : le tisseur lui sacrifie tout, c'est sa vie, c'est son compagnon : il veille sur lui avec une infatigable attention.
On ne voit pas à Lyon de ces grands bâtiments dont l'ouvrier n'est en quelque sorte qu'un rouage mécanique. La cloche n'appelle pas le tisseur à son métier : chaque ouvrier travaille à son heure et au gré de sa propre volonté. Il reçoit directement du fabricant et la matière à employer et le dessin à exécuter. Ainsi habitué à débattre lui-même ses intérêts, l'ouvrier lyonnais jouit d'une indépendance morale dont aucune ville manufacturière ne saurait donner une idée. Le travail lui est confié, l'exécution reste à son libre arbitre.
L'industriel et le producteur, traitant de gré à gré, sont donc sur le pied d'une égalité parfaite. Tandis que les négociants ou fabricants s'occupent de connaître promptement et sûrement la variation du prix des soies, de leur côté les ouvriers, isolés d'abord par la nature même de leur travail, se sont associés plus intimement pour ne pas prendre à plus bas prix que les autres une façon dont quelques-uns pourraient demander un moindre salaire.
Lorsque l'activité du commerce, la multiplicité des commandes, le prix des soies, le défaut de concurrence à l'étranger ou d'autres causes favorables à l'industrie, permettent aux fabricants d'élever le prix des façons en raison de l'augmentation progressive des denrées ou des besoins, l'ouvrier lyonnais, laborieux et satisfait de la rémunération de son travail, reste en parfaite intelligence avec eux.
Peu à peu, du fruit de ses épargnes, il achète un ou deux métiers et, de simple ouvrier, devient propriétaire. Plus tard, il augmente le nombre de ses métiers, jusqu'à ce qu'il devienne fabricant à son tour.Les propriétaires de métiers associés entre eux portaient, en 1834, le nom de Muiuellistes. Les ouvriers en soie, non propriétaires de métiers, également associés, s'appellent les Ferrandiniers.
En réalité, jamais population, soucieuse de ses droits, ne fut par cela même plus intelligente et plus apte à marcher dans la voie du progrès économique.
A ses premières revendications, on répondit par la construction de forteresses, enserrant la ville d'un réseau menaçant. On ne cherchait pas à éviter les collisions, en se préparant à écraser les travailleurs au premier mouvement. Les mutuellistes, qui jusque-là s'étaient tenus à l'écart de la politique, s'affilièrent à la société des Droits de l'Homme. On les arrêta et la police correctionnelle crut avoir abattu les têtes de l'hydre. Le mot sinistre : Il faut en finir, qui se retrouve sur les lèvres des peureux affolés, avait été prononcé !
Ces canuts n'étaient que de la canaille à mitrailler. La lutte ne devait pas tarder à s'engager. Elle éclata. La répression fut terrible ! Le faubourg de la Guillotière fut ruiné par l'artillerie de Louis-Philippe. Dans les rues Raisin, Mercière, des Capucins, des Trois-Maries, place de l'Herberie, rue de l'Hôpital, sur le quai de Flandre, le quai du Rhône, des maisons s'étaient effondrées sous le canon.
"Il est difficile à qui ne l'a pas vu, suivant le Courrier de Lyon, de se faire une idée du triste et désolant aspect qu'a présenté notre cité. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, c'était l'incendie et le combat. Dans nos rues, sur nos quais, silence de mort... c'était quelque chose d'effrayant et de lugubre que ce silence morne qui n'était troublé que par des bruits de destruction...".
Et Louis Blanc a caractérisé en quelques lignes énergiquement vraies l'inhumanité de cette répression barbare : "C'était, dit-il, la démonstration sanglante des vues économiques du régime industriel : c'était la révélation de tout ce que renferme de lâche et d'hypocrite cette prétendue liberté de transaction qui laisse le pauvre à la merci du riche et promet une victoire aisée à la cupidité qui sait attendre sur la faim qui n'attend pas".
Bien souvent, j'ai visité ces ateliers où le tisseur vit avec sa famille, j'ai bien souvent causé avec ces hommes qui sont francs, joyeux, travaillent en chantant et n'exigent même d'autre sécurité pour eux que la possibilité de vivre au jour le jour. "Je me suis battu en 1831, me disait un vieillard. Avais-je tort ? Un tarif avait été débattu entre nos délégués et ceux des fabricants. Le jour où il fut accepté, j'ai illuminé comme les autres. La Croix-Rousse semblait un palais féerique. Le lendemain les fabricants refusèrent de se conformer à ce tarif. C'était une trahison ; j'ai pris le fusil. En 1834, la loi contre les Associations m'a ruiné, je me suis encore battu. Et bien, je vous jure que si, dès cette époque, les patrons avaient voulu s'entendre avec nous loyalement, d'hommes à hommes, en opposant à nos prétentions des arguments et non des menaces, des preuves et non du canon, jamais ces deux insurrections n'auraient eu lieu. Nous battre ! Pourquoi ?... Nous voulons la justice, la rémunération équitable. Nous admettons les bénéfices des fabricants, mais nous nous refusons à subir l'exploitation qui enrichit les uns en tuant les autres !".
Aujourd'hui que l'institution des syndicats est entrée dans les moeurs, les conflits sont rares et facilement prévenus. Ouvriers et fabricants acceptent de mutuelles conventions. La République aidant, la fabrique lyonnaise ne verra plus le retour de ces luttes indignes de l'humanité. C'est pourquoi la population est fermement attachée au seul régime qui, en garantissant la liberté, permette le développement régulier des forces économique.Je reviens à l'intérieur de nos tisseurs.
Dans l'atelier, le plus souvent est installé le fourneau qui sert à la cuisine ; je me rappellerai toujours le cri d'un imbécile qui s'était attaché à mes pas et que j'avais été contraint de piloter : - "Avez-vous vu, s'écria-t-il au moment où nous sortions, il y avait un poulet !... et du vin cacheté !... Ces ouvriers !...".
Et bien , oui -je l'ai déjà dit - l'ouvrier lyonnais aime à bien vivre. Et quoi qu'on en dise, c'est un signe de civilisation. L'amour du bien-être relatif est la première manifestation du respect de soi-même.
A la Croix-Rousse pas d'ivrognes. La grande distraction, c'est la partie de boules au quai d'Herbouville. On y joue volontiers une bouteille de bière.
De neuf à onze heure, les employés se rendent à leur bureau. Le pont Morand est encombré d'allants et venants, je crois qu'il est peu de routes qui soient aussi fréquentées, en quelque ville que ce soit. Certains Lyonnais traversent le pont Morand huit ou dix fois par jour, le matin pour venir de leur domicile des Brotteaux, à midi, aller et retour pour le repas, et souvent ils rentrent deux ou trois fois dans la soirée. Jugez de cette animation !
L'employé entre dans les magasins et jette ce simple mot : Moi ! qui vient frapper l'oreille du patron ou de l'intéressé.
Le magasin est divisé en deux parties distinctes et à personnel complétement divers.
Dans la première partie, vaste, bien éclairée, ce ne sont que sourires gracieux, paroles aimables. On vend. C'est là qu'on reçoit les acheteurs venant des quatre coins du monde. L'Anglais, l'Américain, l'Allemand, l'Australien, le Russe se coudoient. On les voit penchés sur l'étoffe que déroule à demi le vendeur avec une pose élégante. L'acheteur courbé, la loupe à la main, compte les fils, étudie l'effet de près, de loin, au jour, à la lumière. Puis les commandes se soldent par 200, 500, 1.000 mètres. Sourires, sourires sur sourires.
Mais passons de l'autre côté. Là tout est sombre : c'est par derrière, une cour laisse à peine filtrer un rayon de lumière dans l'obscurité. C'est là que l'ouvrier rapporte ses pièces.
Pour descendre de la Croix-Rousse, il s'est installé dans le chemin de fer qui roule comme une avalanche jusqu'au quartier Saint-Clair. Pas de locomotive, un câble qui retient les véhicules ou les hisse à la montée. Cela s'appelle la Ficelle. On paie 20 centimes en premières, 10 centimes en secondes.
L'ouvrier se hâte vers le magasin. Il va toucher son salaire.
Voyez ce guichet devant lequel se presse une foule d'hommes, de femmes, d'enfants. Derrière ce guichet se trouve un personnage rogue, dur, en casquette, qui émaille son langage d'exclamations peu parlementaires.
Il reçoit. L'ouvrier lui passe son rouleau d'étoffe, et ledit personnage l'examine soigneusement.
Son rôle est de découvrir les crapauds, c'est-à-dire les défauts, les fils brisés, les tâches.
Et à chaque découverte, c'est un mot tombant sec comme le marteau du commissaire-priseur. - "Dix sous... Cinq sous... Un franc !"...
Ce qui veut dire réduction de...
L'ouvrier proteste, discute. Ah bien ! oui ! le receveur n'écoute ni n'entend et continue sa litanie monotone. La déduction monte à quelques francs. L'ouvrier veut transiger. Point. Assez. A un autre !... Est-ce que j'ai le temps d'entendre vos doléances !...
Dans un autre coin, vous trouverez les dévideuses qui viennent chercher leurs balles de roquets.
Mais midi sonne : heure du déjeuner. Les patrons vont chez eux, les intéressés, les principaux commis courent au café Forni, place de la Comédie, au café Casati, ou des Deux-Mondes, rue de Lyon.
Là, tout en déjeunant, on brasse des affaires.
L'acheteur étranger est l'objet de toutes les politesses imaginables ; et je vous jure qu'il trouve l'hospitalité large et facile. Il est vrai que la fourchette à la main, les commandes sont si aisées.
La place de la Comédie est encombrée de groupes : c'est la petite Bourse. Chacun raconte les nouvelles, discute les prix, médit des maisons rivales. S'il pleut, on va continuer sous les arcades l'entretien commencé.
A cinq heures, les patrons-tisseurs viennent à leur tour, place de la Comédie, discuter les questions de tarifs, s'entendre sur les contestations soulevées.
De six à neuf, les magasins se ferment, sauf, bien entendu, pendant les jours d'inventaire.
Le Lyon travailleur a fini sa tâche.
Seules quelques lumières brillent encore aux fenêtres de la Croix-Rousse, et le bruit lointain des métiers descend encore vers le fleuve.IV
Lyon religieux
Lyon est, sans contredit, une des villes de France où l'influence religieuse est encore aujourd'hui la plus vivace et la plus forte : les idées modernes, acceptées immédiatement par la classe des travailleurs et peu à peu par la bourgeoisie, peuvent difficilement franchir la barrière que lui opposent les classes dites supérieures.
Ce fait évident trouve sa première explication dans l'antiquité de l'organisation religieuse du diocèse de Lyon.
Le Lyonnais fut, aux premiers temps chrétiens, l'un des premiers domaines sur lesquels s'établit l'autorité religieuse, avec sa puissante hiérarchie : les cures rurales s'étaient accrues, dès les premiers siècles, en telles proportions, qu'on avait dû créer des coévêques, chargés d'administrer les cures sous la direction des évêques de la métropole.
Du XIe au XVIIIe siècle, le diocèse fut divisé en dix-huit archiprêtrés ; mais il semble que ce titre d'archiprêtre remonte à une antiquité encore plus éloignée, car on en retrouve la trace dans un Capitulaire de 844.
Or, ces archiprêtres recevaient un mandat parfaitement défini et dont les détails expliquent à merveille l'autorité dévolue aux membres du clergé dans le Lyonnais.
Les circonscriptions épiscopales, grâce à l'immutabilité du clergé catholique, restèrent intactes jusqu'à la Révolution. L'archevêché de Lyon constituaient un véritable royaume, s'étendant jusqu'à l'Océan. Le primat des Gaules avait juridiction sur les provinces de Lyon, de Sens, de Tours, de Rouen. Ce fut la Révolution qui, par la loi du 24 août 1790, décidant que chaque diocèse serait borné à un seul département, réduisit celui de Lyon à l'étendue du département de Rhône-et-Loire créé au mois de janvier précédent.
Mais on comprend quelle fut pendant de longs siècles la domination exercée par ce souverain, revêtu de titres solennels, et auquel, pendant toute la période féodale, le peuple eut plus souvent recours qu'au roi, qui était si loin.
Jadis Saint-Jean avait deux satellites sur son flanc nord, avec lesquels elle figurait, dit-on, les mystères de la Trinité.
C'était l'église de Saint-Etienne, bâtie au IVe siècle, après l'église de Sainte-Croix qui datait du commencement du IVe siècle.
L'église de Saint-Jean remonte au VIe siècle, mais ce n'est qu'au XIIe siècle qu'elle fut reconstruite sur le plan actuel, pour n'être terminée qu'au XVe. Aussi le style porte-t-il le cachet des trois architectures gothique, de transition et de renaissance, sans que cependant le monument manque d'unité architecturale. L'alternance du plein cintre et de l'ogive produit un effet remarquable et prouve une hardiesse de vues peu ordinaire.
Bâtie au pied du coteau de Fourvières, Saint-Jean semble la sentinelle avancée de la cité religieuse, qui s'étend sur la hauteur.
Peu à peu, la ville travailleuse a reconquis pied à pied le terrain qui lui avait été enlevé : les murailles sont tombées, les fossés ont été comblés ; à peine une place étroite permet-elle à l'artiste d'étudier la façade du monument jadis isolé.
Le chevet de l'église s'avance vers la Saône comme si son grand corps cherchait à aspirer l'air, jalouse qu'elle est de l'antique Fourvières, toute baignée de soleil et de lumière.
En 1475, Louis XI, jaloux de se réconciler avec le clergé dont l'opposition centuplait les difficultés de la lutte qu'il soutenait, résolut de donner à ses ambitions une éclatante satisfaction.
Sur le coteau qui domine la ville, s'élevait déjà une chapelle placée sous le vocable de Notre-Dame de Bon Conseil. Louis XI, pour qu'il y fût dit tous les jours quelques messes à son intention, lui attribua les rentes et gardes de Saint-Symphorien le Châtel et la ferme de la châtellerie de Charlier.
Voici en quels termes sont motivées ses lettres patentes :
"Ayant considération aux très-grandes et singulières grâces que Dieu notre Créateur nous a faites par ci-devant, à l'intercession de sa benoiste mère, la glorieuse Vierge Marie, à laquelle après Dieu son fils, nous avons toujours eu spécial refuge et espérance, et laquelle, en la conduite de nos plus grands faits et affaires, nous a toujours imparti sa grâce et intercession envers Dieu son fils, tellement que par son moyen et aide, nos royaumes et seigneuries sont, grâce à Dieu, conservés, entretenus et demeurés en leur entier sous nous et notre vraie obéissance, nonobstant quelconques entreprises, machinations et conspirations qui aient été faites depuis notre avénement à la couronne, tant par nos ennemis et adversaires que autres nos rebelles et désobéissants sujets, leurs adhérents et complices, pour ces motifs nous instituons la fondation qui suit...".
Et il monta, comme pèlerin, à Notre-Dame de Fourvières pour y prier au pied de son autel privilégié.
Commines ne faillit pas à dire que "Notre-Seigneur fit miracle sur lui, et le guérit tant de l'âme que du corps".Dès longtemps, le sanctuaire de Fourvières jouissait d'une réputation que nul ne songeait à discuter.
Lors du siège de Lyon par Sévère, le vaste Forum de Trajan avait été saccagé. Le centre de la cité allait se déplacer, la vie pratique descendit vers la Saône. La religion, avec son intuition de mysticisme, comprit quelle admirable situation s'offrait au culte poétique de la Vierge.
Il est indéniable que jamais l'intelligence humaine n'a prouvé plus d'habileté, plus de connaissance du coeur, plus profonde analyse de la sentimentalité que dans l'établissement, l'organisation de ces pompes catholiques, qui parlent à la fois aux sens et à l'âme. Ce culte de la Vierge, avec sa douceur béate, son indulgence, sa pitié charmante, devait, avant tout, s'imposer aux craintifs et aux persécutés. Ils se sentaient loin du roi, avons-nous dit ; plus loin encore de Dieu, qui ne leur apparaissait que derrière les murailles féodales de Saint-Etienne ou de Saint-Jean. La Vierge était l'avocat, l'intermédiaire, aux bras toujours ouverts, au sourire toujours bienveillant.
Ce nom de Notre-Dame de Bon Conseil était admirablement trouvé pour répondre à ce besoin d'appui dont les misérables étaient obsédés.
Tandis qu'au XIIe siècle, on se battait pour se disputer le siége primatial, tandis que Guichard et Drogon luttaient pour le pape ou l'antipape, les moins ambitieux, mais plus habiles archeprêtres agrandissaient le sanctuaire. Cependant les maîtres de Saint-Jean s'inquiétèrent de l'importance prise par le nouveau culte et exigèrent des chanoines de Fourvières hommage de vassalité.
Les chanoines consentaient à s'incliner, mais ils prenaient leur revanche. C'était du haut de Fourvières qu'Innocent IV bénissait solennellement la ville ; de quatre chanoines, le nombre était porté à dix, et ils avaient droit à la mître dans les cérémonies publiques.Cette lutte est curieuse à suivre à travers les siècles.
En vérité, Fourvières remportait sans cesse de nouvelles victoires.
Les consuls du XIVe siècle, pour obtenir le droit de placer un veilleur sur la hauteur, venaient humblement remettre au chapitre de Fourvières les clefs d'une des portes de Lyon.
Mieux encore. Les comtes de Saint-Jean, pour obtenir du ciel meilleure protection dans leurs guerres, se rendent processionnellement à Fourvières, délaissant eux-mêmes le sanctuaire de Dieu pour celui de la Vierge.
Mais le temps des épreuves était arrivé, et lors du pillage de Lyon par le baron des Adrets, Fourvières fut complétement saccagé.
Singulière figure que celle de ce bandit, qui, après la victoire, après le massacre, décrétait que "chacun, était libre en religion". Mais le triomphe des calvinistes fut de courte durée, et Fourvières put prendre sa revanche.
La peste décimait les Lyonnais : à qui s'adresser ? à quelle intervention recourir ?... Soixante mille êtres humains avaient péri... Fourvières n'existait plus. Le P. Auger voua la ville de Lyon à Notre-Dame du Puy.
"Les prêtres du chapitre de Fourvières, dit un écrivain catholique, étaient dans la consternation... Le dimanche 18 juillet 1563, les quelques cloches échappées à la fureur des huguenots appelèrent, après treize mois de silence, les catholiques à Saint-Jean".
C'était la ruine de Fourvières, mais le chapitre de Saint-Jean eut pitié de ses confrères, et une première allocation de deux mille livres tournois aida à réparer les désastres.
Nouvelle peste. Fourvières n'est pas reconstruit encore. Les Lyonnais s'adressent à Notre-Dame de Lorette.
Par bonheur, l'honnête Henri III vint à Lyon, et s'enrôlant parmi les pénitents blancs du Gonfalon, revêtu de la robe de bure des pénitents, il gravit la colline de Fourvières.
L'autel de Fourvières fut relevé. "La source des prodiges y semblait tarie, dit un historien, mais ils recommencèrent à la fin du XVIe siècle et tout Lyon en ressentit une grande joie". En effet, ajoute un naïf panégyriste, les Lyonnais n'avaient plus à faire d'aussi longs pélerinages dans leurs calamités.
Dès lors, l'influence de Fourvières ne cessa de grandir.
Louis XIII - ce vertueux prince - passa à Lyon pour aller s'emparer de la Savoie et y laissa Anne d'Autriche.
"Peut-être, dit le Fourviériste que je suis pas à pas, est-ce aux prières de ce pélerinage que nous devons la naissance de Louis XIV !".
La reconnaissance des Lyonnais paraît devoir être mitigée par le souvenir de la révocation de l'Edit de Nantes. La naissance de Louis XIV est de la part du ciel une faveur tout au moins discutable.
La foudre tombe sur Fourvières. Autre effet de la protection divine, car "elle ne laisse d'autre trace de son passage qu'une ouverture parfaitement circulaire, pratiquée dans la voûte, par laquelle une colonne de lumière semblait inonder le sanctuaire de la splendide lumière des cieux..., manifestation de Dieu, qui voulait qu'il resplendît d'un éclat plus grand".
Nouvelle peste. Trente-cinq mille victimes. La population se porte à Fourvières avec une telle affluence qu'il faut ouvrir une nouvelle porte... Par contre, Louis XIII, qui revenait de Savoie et se trouvait malade, doit à un prodige de la protection de Fourvières le rétablissement de sa santé.
Miracles sur miracles. Aussi, le Corps consulaire traite définitivement avec Fourvières par un acte solennel. "L'affaire mise en délibération, a esté résolu que sur la terrasse qui est au-devant de la loge des Changes, à l'endroit qui sera jugé le plus honorable et le plus commode, l'on dressera un piédestal de la hauteur de cinq pieds et demi, fait de bonne pierre noire de Saint-Cyr, bien polie... et que sur ledit piédestal sera posée une figure de la Vierge, faite de marbre blanc, de la hauteur de cinq pieds...".
"Lesdits sieurs prévost des marchands et échevins... ont résolu qu'ils iront, à pied, toutes les fêtes de la Nativité de la Vierge, sans robes, néanmoins avec leurs habits ordinaires, en la chapelle de Notre-Dame de Fourvières".
Cette déclaration arrêta immédiatement le fléau qui ne tua, ainsi que nous le disons plus haut, que trente-cinq mille victimes.
Les offrandes affluaient, comme de raison. La confrérie de Fourvières fut organisée de nouveau et dotée par le pape d'indulgences et d'immunités.Voici 1789. Jetons un voile. Il y a dans les Annales de Fourvières un long silence. Les miracles cessent. Les biens sont déclarés propriété nationale, et comme il fallait défendre la patrie contre l'étranger et qu'on avait besoin d'argent, on envoie les vases sacrés à la Monnaie.
Pierre Scize, ancienne résidence ou plutôt Bastille des archevêques, est jetée bas.
Les protecteurs de Lyon ont un moment d'espoir. Grâce aux royalistes, on tente d'arriver à séparer Lyon de la France. La Convention y met bon ordre. Fourvières est desservi par des prêtres assermentés. "Oh ! oui ! s'écrie Bécoulet, dans son histoire de la Sainte Colline, dans ces jours malheureux, Marie dut opérer bien des prodiges de bonté. Elle seule en a le secret !".
Grâce au zèle de Napoléon, Fourvières se relève encore. Et en 1805, des fêtes splendides accueillent l'empereur et quelques jours plus tard Pie VII.
Il est vrai que les adeptes de Fourvières saluèrent avec non moins d'enthousiasme le retour des rois légitimes.
"Presque toutes les paroisses envoyaient à Fourvières (1815) de nombreuses députations qui déposaient pour ex voto dans le sanctuaire de magnifiques bannières que les journées de 1830 firent ensuite reléguer dans la poussière de l'oubli".
Cependant les miracles se faisaient rares : il était nécessaire, pour la bonne administration de la Sainte Colline, que la protection divine se manifestât d'indiscutable manière. Ce fut ce qui arriva, et voici comme.
Le 9 janvier 1820, alors que la Saône charriait d'énormes glaçons, les entrepreneurs des coches donnèrent ordre de remonter les bateaux amarrés au port Neuville. Mais, le courant étant trop violent, quatre mariniers se virent entraînés contre une arche où les bateaux se brisèrent. Trois d'entre eux se sauvèrent immédiatement, mais un quatrième, moins agile, ou réservé pour donner une preuve éclatante de l'intervention virginale, tombe à l'eau, nage, atteint un glaçon, s'y hisse et là appelle à l'aide. Trois hommes courageux se jettent dans une barque et l'arrachent au péril.
Au premier coup d'oeil, rien de plus simple. Trois médailles de sauvetage et voilà qui paraît réglé civilement.
Mais le marinier déclare - sans doute après avoir remercié ses courageux sauveteurs - qu'il a tendu les mains vers le ciel et adressé un voeu à Notre-Dame de Fourvières... "Après de pareils faits, dit Bécoulet, qui oserait nier l'intervention de Marie pour sauvegarder ses enfants dans les périls ?".
Vint 1830.
"Le triomphe du peuple fut doux et paisible, il était comme un lion enchaîné et maîtrisé par une main plus puissante que sa colère. Cette main, c'était celle de Marie... et elle était si évidente que les Lyonnais attribuèrent leur modération à un miracle de Notre-Dame de Fourvières".
Choléra, inondations, tout est matière à miracle. Les ponts s'écroulent, Vaise est dévasté, avec Saint-Georges et la partie basse de la ville. Les maisons s'effondrent. Mais le séjour des eaux dans les rues étroites n'y fit naître aucune épidémie : il fut évident que la rigueur de "l'irritation du Fils de Marie fut bien tempérée par la prière de sa sainte mère".
Quant aux maladies incurables, toute résistance de leur part serait une preuve de mauvais goût.
Le 18 août 1845, une dame C. A., malade depuis 23 mois, se fait porter à Fourvières. "Tout à coup elle entend au fond de son coeur une voix qui la presse de se lever : elle demande ses souliers... la voilà debout ! elle est guérie". Autre aventure de souliers qu'un frère est obligé d'aller chercher pour un paralitique qui depuis plusieurs années avait une jambe ankylosée !
En 1848, le cardinal de Bonald autorise les confréries, associations, communautés à commissionner à la fabrique lyonnaise une bannière en soie bleue avec cette inscription significative :O Marie, protégez la France. 1848.
Et quand est élevée la statue colossale qui domine la colline, on grave cette inscription dans le socle :
O MARIE
Cette ville est à vous.
Protégez-là.Et ce n'est pas là un vain mot : on peut en juger par ce nouvel extrait des brochures fourviéristes :
"De Fourvières, dit le livre de M. Louis Léopold Bécoulet, le spectateur contemple avec admiration le magnifique panorama qui se déroule à ses pieds. Et c'est dans cette étroite enceinte que les intérêts, les passions animent quelques milliers d'hommes, les uns vivant aux dépens des autres, en exploitant leurs forces et leur misère. Oh ! que d'iniquités, quand on y pense ! Pour une pièce de monnaie, un misérable, digne des plus terribles châtiments, va séduire l'innoncence !... c'est là qu'on trouve réunis l'excès de la misère et de la grande opulence, les vertus les plus rares à côté des vices les plus hideux, le génie et la stupidité, la piété la plus sincère et la plus froide irréligion...".
Que dites-vous de ce tableau ? et quelle douce charité respire ce court factum !
Rien de ce qui est travail, intelligence, vie sociale, ne trouve grâce aux yeux des hommes de Fourvières. A l'ouvrier, ils crient que le patron exploite sa misère ; au patron, que l'ouvrier dessèche d'envie !
Donc, vous tous qui avez besoin de consolations, venez à nous !...
Le Deos fecit timor est toujours vrai. Se redoutant les uns les autres les hommes vont au prêtre derrière lequel ils croient voir Dieu. Et le prêtre se sent d'autant plus fort que ces hommes sont adversaires plus violent.
S'ils se connaissaient, s'ils s'estimaient, s'ils s'entendaient, tout serait perdu et les sanctuaires seraient déserts. Comme, à ce point de vue, les quelques lignes citées plus haut renferment un grand enseignement, en indiquant aux hommes de l'avenir le véritable moyen de ramener l'humanité à son véritable principa de justice, par l'association et la solidarité !
Quoi qu'il en soit, Fourvières grandit, fière de ses quinze cent mille pélerins et de ses trois mille kilogrammes de cierges brûlés chaque année.
"A Fourvières, dit Bécoulet en style de réclame, on est toujours sûr de trouver à toute heure des jeunes gens vertueux, des mères pieuses, des jeunes filles ferventes et sages...". J'ai écrit le mot de réclame et je ne l'efface point : car cet "on trouve à toute heure..." cache un sens profond.
La grande puissance du clergé à Lyon, c'est le mariage. Toute mère qui veut établir son rejeton va, sans hésiter, frapper à la porte de la sacristie : "Voici ce qu'il me faudrait, dit-elle, comme âge, comme fortune, comme situation". Le personnage réfléchit un instant, et dans l'assortiment prêt à toute heure il trouve le phénix qui répond au programme tracé ! Fourvières est l'agence matrimoniale par excellence.Le libre penseur est - ou plutôt était, il y a quelques années encore - la bête noire des Lyonnaises, donc des Lyonnais.
Je connais un excellent médecin, habile entre tous, travailleur, d'une intelligence hors ligne. Il appartient à l'école réaliste, et ne croit pas que Lourdes, la Salette et Fourvières soient les officines de panacées universelles. Aussi quelle lutte ! que d'obstacles !... Rien pour le réprouvé ! Il fallut qu'à coups de science et de volonté il se frayât une place. Le docteur X... (tout Lyonnais sait son nom) confit en sainteté, bénisseur et béni, tenant le haut bout du pavé, s'était érigé en adversaire implacable de l'incrédule. Et les années passaient, et les injustices les plus criantes repoussaient le libre penseur de tous les hôpitaux. Quand il a fallu céder, sous la pression de l'opinion publique, les sacristains ont courbé la tête en frémissant d'indignation. Mais l'homme énergique a franchi la passe terrible, et aujourd'hui c'est un des premiers médecins de Lyon. Seulement, il a perdu dix ans. Combien d'autres se sont découragés !
Mais le temps va et le progrès marche.
Pour preuve, je veux rappeler certaine anecdote méchamment racontée par Stendhal : "J'entrai chez un libraire pour acheter un livre. Je ne savais quoi demander. Je nommai au hasard Jacques le Fataliste ou les romans de Voltaire. Le libraire recula d'un pas, prit un air morose et me fit un sermon sur l'immoralité des ouvrages dont je lui parlais. Il finit par m'offrir le Spectacle de la nature de l'abbé Pluche".
Aujourd'hui, le libraire serait introuvable, comme le Spectacle de la nature.
En revanche, Voltaire est partout, ce qui vaut mieux.
Je suis allé visiter une Providence sur la colline sacrée.
Je ne saurai rendre l'impression froide et à la fois étouffante qu'on éprouve en pénétrant dans ces asiles dont notre Sainte-Périne si gaie, si proprette ne saurait donner la moindre idée.
J'y venais voir une vieille dame que j'avais jadis connue, alors qu'elle brillait de tout l'éclat de ses quarante années, dodues et fraîches, aux messes de dix heures. Quel changement depuis que, moyennant une petite rente, elle avait obtenu le droit de se réfugier à l'ombre de l'autel privilégié ! Pâle comme une statue de cire, avec ses grands yeux éteints, elle était émaciée à ce point qu'un souffle dût suffire pour l'emporter aux régions célestes.
Après les banalités d'usage, elle ne me dit qu'un mot : - "Sont-ils toujours aussi méchants... en bas ?"...
Cet "en bas" désignant la ville n'avait-il pas comme un parfum d'enfer ? J'essayai de la rassurer, mais comme je plaidais la cause des braves gens qui gagnent leur vie, la porte s'entr'ouvrit, et une figure ronde et béate parut dans l'entre-bâillement... je me levai et saluai. Si bon avocat que je fusse, la partie n'était pas égale : elle était gagnée d'avance par ceux d'en haut.
Et descendant la montée Saint-Barthélemy, me croisant avec les innombrables ecclésiastiques qui semblent des sentinelles veillant sur une citadelle, je répétais tout bas le mot de Voltaire : "L'instruction fait tout : c'est la source féconde de l'ordre, du repos et du bonheur".V
Physiologie lyonnaise
Mais, me dira-t-on, vous passez bien rapidement sur deux points des plus importants. Tout d'abord, il est à Lyon nombre de monuments que vous n'avez même point nommés. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?
Certes, je m'expliquerai très-nettement.
Je prétends d'abord qu'en fait de monuments, rien n'est plus parfait, au point de vue descriptif, que les Guides de tout format et de toute édition. C'est là de la littérature qui procède la toise en avant, qui mesure la hauteur des combles, la largeur des façades, qui numérote les tours et compte les clochers ; le dessinateur aidant, voilà qui est complet.
Pour peu que vous ayez d'imagination, jetez les rayons d'un lumineux soleil sur l'Hôtel de Ville, disposez habilement un clair de lune derrière Saint-Nizier, estompez l'abside de Saint-Martin d'Ainay d'un brouillard d'aurore, et le monument vous apparaît dans toute sa netteté.
Tenez-vous fortement à savoir si le gothique l'emporte sur le roman, s'il y a des hybridité de styles, ou pureté de lignes, les monographistes ne manquent pas. Et point n'aime refaire ce que mes devanciers ont très bien réalisé. Mérimée, qui n'était pas encore, en 1839, le styliste gaillard de la Chambre bleue, a, pour l'édification des archéologues, classé les pierres lyonnaises, comme fait un entomologiste avec les hannetons de ses tableaux vitrés, sans compter les Richard, les Joanne, qui dirigent votre admiration sur le point juste, et ne vous font grâce ni d'une rosace XVe siècle, ni d'un jubé moyen âge.
C'est leur devoir, et ils l'ont rempli. D'où mon excuse, si j'ai passé assez rapidement sur les splendeurs architecturales de la ville de Lyon.Le second reproche qui me peut être adressé est plus grave, en ce sens qu'il est plus juste.
Je n'ai pas encore écrit la physiologie du Lyonnais, je n'ai point étudié à la loupe ses qualités ou ses défauts, disséqué, scalpel en main, chaque lobe de son cerveau, ou les ventricules de son appareil cardiaque...
Or, pour cette abstention, toute excuse serait inacceptable. Si les choses de pierre m'attirent peu, les détails psychologiques me sont imposés.
Ceci étant juste, et toute hésitation étant superflue, je me lance dans cette étude, pour laquelle je réclame, ainsi que de raison, toute l'indulgence de mes lecteurs lyonnais.
J'espère, d'ailleurs, que cette indulgence me sera facilement acquise, lorsque j'aurai déclaré, avec la franchise brutale d'un analyste émérite, que je pense en général le plus grand bien des Lyonnais, et que leur caractère m'est de tout point sympathique.
Stendhal, qui les détestait cordialement, ne leur a épargné aucune attaque.
Je résume quelques-uns de ses griefs : "Le dieu du pays... c'est l'argent !" - "La physionomie du négociant lyonnais, c'est celle d'un Barrême mécontent, s'il vient de faire une perte de 20 francs" - "Tout ce que le petit commerce, qui exige de la patience, une attention continue aux détails, l'habitude de dépenser moins qu'on ne gagne et la crainte de tout ce qui est extraordinaire peut produire de niaiserie égoïste, de petitesse et d'aigreur dissimulée par la crainte de ne pas gagner, me semble résumé ici".
Certes, voilà un réquisitoire en règle. Mais ce n'est pas tout, et Stendhal, qui était avant tout un ciseleur de paradoxes, ne s'arrête pas en si beau chemin.
"Dès que je suis dans cette ville, j'ai envie de bâiller... Un des agréments du caractère lyonnais, c'est de se piquer facilement... Ces gens-là s'imaginent qu'on pense à eux et à les humilier".
Il est vrai qu'au temps où il écrivait ses Lettres d'un voyageur, les maisons à six étages ne permettaient pas au soleil d'arriver jusqu'au pavé ; ce qui ne contribuait pas peu à l'aigrir. Peut être, s'il eût connu la rue de Lyon et la place des Jacobins, son irritation mal contenue se fût-elle calmée d'elle-même.
C'est avec une joie franche qu'il constate combien Lyon déchoit depuis quelques années (1837)... Les ouvriers en soie chantent dans les rues en demandant l'aumône... Un gouvernement courageux devrait exiger du clergé de Lyon de ne pas pousser les ouvriers au mariage...
L'idéal de Stendhal serait la dépopulation malthusienne. Laissons là ce misanthrope égoïste, et tâchons de dégager cette inconnue qui s'appelle le caractère typique d'une population.
Le Lyonnais est-il avare, dur, intéressé ? Sont-ce donc là des épithètes adressées aux Anglais ? Non. Dès lors, pourquoi ces deux mesures ?
Il existe de grands rapports entre les deux caractères. Le Lyonnais est un Anglais mâtiné de Parision, ce qui ne gâte rien.
Dans tout pays où le travail est en quelque sorte l'acte le plus visible, le plus frappant de la vie sociale, le caractère perd rapidement l'insouciance qui sied si bien aux fanfarons de flânerie.
Il n'y a qu'à Paris qu'on puisse prononcer, en parlant d'un jeune homme, cette phrase proverbiale : De quoi vit-il ? Il est de bon goût, dans notre ville toute d'apparence, de vie rapide et quasi facile, de ne jamais parler de ses propres occupations. Rien n'est de plus mauvais ton, au boulevard Montmartre comme dans les salons bourgeois, que de sans cesse entretenir les autres des péripéties de sa profession : si bien que la suprême élégance, c'est de laisser planer sur le fonds même de ses ressources une sorte de mystère.
En province, point. Chacun est tenu de déclarer hautement ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il acquiert, ce qu'il espère. A Lyon, plus que partout, cette observation est vraie. Qui ne fait rien est ou un oisif dangereux ou un viveur qui jette au hasard les écus amassés par le père. La chevalerie d'industrie ne peut arborer son drapeau ; qui parle de projets énormes est mis en défiance ; qui compte sur l'avenir sans donner de gages au présent est côté bas. Et c'est justice.
A Lyon, tout enfant est, dès sa puberté, destiné à une profession nettement définie.
Ouvrier, il reprendra le métier du père. Négociant, le même comptoir lui ouvre les bras de son fauteuil de cuir. Cela est dans le sang : on se sait né pour travailler : on n'admet point ces prétendues vocations qui vous entraînent vers un idéal indéterminé et qui le plus souvent ne sont qu'un ferme désir de se croiser les bras.
D'où une note sérieuse dans l'esprit. Soyez jeune, riez, amusez-vous, faites même des folies, très bien. Vous jetez votre gourme. Mais il y a, il doit exister en vous une graine de travailleur qui germe déjà et grandira à l'heure voulue. Le mariage vous guette et avec lui la vie raisonnable et rationnelle.
Chez beaucoup, cette connaissance d'un avenir imposé par la volonté du père, par l'air qu'on respire à Lyon, par le bruissement d'effort qui murmure de la Croix-Rousse aux Brotteaux, développe une certaine défiance qu'on prend trop souvent pour de l'égoïsme.
Le vrai mot, c'est le génie de la concurrence. J'ai nommé l'Anglais. Voyez-le dès sa première jeunesse : il est enveloppé par le rayonnement de ce mercantilisme (je prends le mot en très bonne part), et dès que la raison s'éveille en lui, il devine que son initiative propre est une arme qui lui servira dans le combat de la vie. Vendre, acheter, tout se résume là. Vendre sa peine ou ses idées aussi cher que possible, acheter les matières premières au meilleur compte, là est le mécanisme de toute machine industrielle : Londres, Sheffield ou Lyon ont la même formule.
Stendhal trouve au Lyonnais une physionomie de Barrême. Il y a du vrai, mais savoir compter n'est pas un crime. Lyon a sa mission en France comme Paris à la sienne. Fantaisiste sur le bord de la Seine, l'esprit français est méthodique sur les rives de la Saône.
Où est le mal ? La France est un immense cerveau dans lequel se balancent toutes les tendances, tous les spécialismes, pour constituer cette unité splendide et multiple qui s'appelle la patrie.
Ne pas travailler est à Lyon une note déshonorante. Blâme qui veuille. Pour nous, rien ne nous paraît plus beau que ce rôle net, utile, en quelque sorte généreux, dans lequel se renferme la seconde ville de France.
Paris, musée d'art, d'initiative, de fantaisie intellectuelle. Lyon, atelier.
Acceptez cette distinction, Lyonnais. Elle vous fait honneur et constitue votre plus grand titre.Donc le Lyonnais est soucieux de ses intérêts ; est-ce à dire qu'il conserve en toutes circonstances une attitude gourmée ? Le croire, ce serait m'avoir bien mal compris. Il y a temps pour tout ici comme ailleurs, et nul ne sait mieux que le Lyonnais mettre à profit les heures de loisir que lui laisse le travail.
Le peuple de Lyon est actif, vivace, d'une gaieté communicative.
"Bon coeur, assez enclin à la bamboche, n'ayant pas trop de scrupules, il est toujours prêt à rendre service aux amis ; ignorant, mais fin et de bon sens, ne s'étonnant pas facilement, on le dupe sans beaucoup d'efforts en flattant ses penchants, mais il parvient toujours à se tirer d'affaire...". Tel est, résumé en quelques lignes par un observateur, le vrai caractère du Lyonnais. Et ce portrait, c'est celui du célèbre Guignol, de cette marionnette essentiellement lyonnaise, qui est à la fois type et caricature et qui offre cette singulière preuve de bon goût, donnée par une population, applaudissant aux facéties satiriques de son Sosie.
"Ce que je sais, écrit l'aimable et érudit magistrat auquel nous devons la publication du théâtre de Guignol, c'est que j'aurais pour l'éducation du peuple encore plus de confiance à Guignol qu'à la plupart de nos grands auteurs dramatiques".
Guignol est honnête, avant tout.
Dans les Couverts volés, quand il reconnaît Scapin qui vient s'introduire chez son maître Cassandre, Guignol, qui sait son passé de voleur, s'écrie :
- Je ne veux pas que tu lui fasses la barbe... je vais l'avertir...
- Guignol ! s'écrie Scapin, ne me perds pas, je t'en supplie... j'ai été plus malheureux que coupable... tu le sais...
- Oui ! et ces couverts que t'avais dans ta poche, ils y étaient donc venus tout seuls ?
- Un hasard fatal... garde-moi le secret du passé et ne me fais pas perdre la place que je viens d'obtenir chez M. Cassandre.
- Au fait, il a p'têtre changé, faut avoir pitié du pauvre monde ! dit Guignol à part.
Mais quand Scapin le remerciant lui tend la main :
- Ah ! non, non ! s'écrie Guignol, ne me touche pas. Tu as eu la fièvre de rapiamus, ça se rpend p'têtre, ça !...
Et quand pour prix de sa bonté, Scapin l'accuse de vol, quand on le chasse, qu'on le traque, Guignol s'enfuit dans la forêt. Et voilà que le Génie du Bien vient à son secours.
"Sois toujours vertueux, lui dit le Génie. Ne donne jamais ta confiance et ton amitié à de mauvais sujets comme ce Scapin et que son exemple t'apprenne à rester fidèle à ton devoir... Je te quitte... appelle-moi quand tu auras à faire une bonne action...".
Et le Lyonnais applaudit, et ces bonnes vérités, franches et simples, le touchent plus... que bien d'autres prêches.
Il est vrai que Guignol est un peu gobeloteur...Vraiment, Messieurs, si je n'avais pas faim,
Je vous chant'rais tout de suite une ariette ;
Mais mon gosier réclame un verre de vin
Et j'craindrais pas d'siffler une omelette.
Permettez-moi d'm'arroser le fanal
Et j'reviendrai chanter l'couplet final...Quand il se met à mal faire, il ne vaut guère mieux qu'un autre. Et d'un gourmand !
Un mot charmant au passage.
Son maître l'accuse d'avoir mangé un pot de confitures...
- Le coupable s'est trahi, dit-il à Guignol, on voyait la trace de tes doigts.
GUIGNOL. - Par exemple ! je ne les ai touchées qu'avec ma langue.
OCTAVE. - Tu l'avoues donc, malheureux !
GUIGNOL, à part. - Gredine de langue ! scélérate ! Va, je te loge, je te nourris et tu parles contre moi ! sois tranquille. (Il se soufflette et se cogne contre le montant).Plus je lis le répertoire de Guignol, et plus j'y trouve la véritable physiologie du Lyonnais.
VICTOR. - Je suis étranger dans cette ville... Voudriez-vous me rendre un petit service ?
GNAFRON. - Ah ! M'sieu, on voit bien que vous ne connaissez pas les Lyonnais... Y a jamais d'étrangers chez nous..., pardonnez-moi, M'sieur, de vous d'mander votre état...
VICTOR. - Je suis rentier.
GNAFRON. - M'sieu n'aurait pas besoin d'un associé par hasard ?
Quelle bonne et franche gaminerie ! et que d'émotion dans cette pièce des frères Coq qu'on appelle à bon droit le chef-d'oeuvre du théâtre Guignol ! il est dans les moindres détails une délicatesse de probité naïve qui, malgré soi, touche jusqu'aux larmes...
A tout instant, revient cette explication typique du Guignol :
- S'il n'a pas d'instruction, l'intelligence ne lui manque pas. Puis il a un bien bon coeur...En vérité, je citerais tout. Il me faut me borner cependant, et pour achever en quelques traits cette physiologie de l'ouvrier lyonnais, je me permettrai encore un emprunt - cette fois au Portrait de l'Oncle.
Guillaume cherche à perdre Guignol dans l'esprit de son Oncle Durand.
GUILLAUME. - Il a des dettes.
DURAND. - Ah ! sont-elles fortes ?
GUILLAUME. - Il doit par-ci, par-là, à son épicier, à son boulanger. Il a emprunté vingt francs à l'un de ses amis...
DURAND. - L'hiver a été mauvais, le travail a manqué. Il n'y a pas de mal à emprunter dans un moment de gêne. Vingt francs, ce n'est pas une grosse dette, il pourra rembourser.
GUILLAUME. - Oui, s'il travaillait, s'il avait de l'ordre ; mais c'est un flâneur sempiternel ; on le voit à tout instant au cabaret.
DURAND. - Est-ce qu'il y va souvent ? je sais qu'on l'y voit quelquefois le dimanche de loin en loin. Il est bien permis de prendre parfois un peu de distraction... quand il n'y a pas d'abus...
Et quand Guignol, grâce à son bon coeur, reçoit la récompense qui lui est due, c'est lui qui débite au public cette petite morale :
"Dans le monde, le mieux encore, c'est de filer droit son chemin, et celui-là qui est le plus dupe, c'est souvent celui qui a voulu être fripon... Messieurs, c'est un portrait que nous avons voulu vous donner, un portrait du bon vieux temps et de la bonne franquette lyonnaise... Le portrait vous a paru ressemblant, agréez-le avec indulgence".
Guignol est prophète à ses heures.
Il prédisait, en 1865, l'impôt des allumettes !
Que si mon ami et touriste auquel j'ai déjà donné quelques conseils veut bien se rendre un soir rue Ecorche-Boeuf, il comprendra tout ce que la naïveté et le franc bon sens donnent de gaies satisfactions à des hommes redevenus enfants.
Dans une salle peu spacieuse, d'une décoration plus que modeste, il trouvera pressés sur les bancs de bois trop étroits les ouvriers de la Croix-Rousse ou de Saint-Pothin. Femmes, enfants, le cou tendu, s'efforcent de ne pas perdre un mot des inénarrables facéties de Guignol. Et ce sont des éclats de rire, et des trépignements quand par une allusion, ajoutée de toutes pièces, le héros légendaire touche à quelque question du moment. Hélas ! la censure cependant a fait invasion dans la baraque de la marionnette, et au nom du péril social, on impose silence aux malices du bonhomme. Mais il sait son public, et sans avoir l'air de rien, il peut par une simple inflexion de voix, par un jeu de scène, par un coup de bâton appliqué à propos, clouer l'ennemi au pilori de la baraque.Autres traits du caractère lyonnais.
Son esprit satirique s'exerce par toutes voies. Les surnoms sont à la mode, et plus d'un personnage porte toute sa vie - sans pouvoir s'en défaire - tel sobriquet que lui a valu telle ou telle aventure. On comprendra que je m'abstienne des personnalités, en ce qui concerne les vivants.
Mais tous les Lyonnais se souvienennt encore de certain agent de change - banqueroutier plus tard - qui, en 1814, lorsque la duchesse d'Angoulème arriva à Lyon, détela lui-même les chevaux de sa voiture, se substitua à ces animaux et voulut avoir l'honneur de traîner la Dauphine jusqu'à l'hôtel qu'elle devait habiter... Il se nommait Coste. Mais pendant de longues années et jusqu'à sa fuite frauduleuse, on ne le désigna que sous le nom de Cheval, qu'il avait d'ailleurs si bien mérité.
Tel autre était surnommé La Malle, par suite de je ne sais quel bruit répandu dans le public et qui attribuait l'origine de sa fortune à certaine malle à lui confiée pendant la Révolution et non restituée depuis lors.
Puisque je suis sur le chapitre des anecdotes lyonnaises, en voici une qui vaut son pesant d'or.
Le 25 octobre 1817, M. le maire de Lyon rendit une ordonnance concernant les décrotteurs ; en voici le texte exact :
"Les permissions ne seront accordées, pour le nombre de décrotteurs fixé par l'article Ier, qu'aux individus porteurs d'un certificat du curé de leur paroisse, constatant qu'ils assistent aux instructions chrétiennes et remplissent leurs devoirs religieux".
Ce maire était le comte de Fargues. On le chansonna. Je cite un couplet :Nos souliers ne sont plus cirés
Sans l'agrément de nos curés.
Il veut qu'on ait l'âme bien pure
Pour nettoyer notre chaussure.
Ah ! ah ! ah ! oui, vraiment,
Monsieur le Maire est bon enfant...Pourquoi Stendhal bâillait-il si fort à Lyon ?
Pourquoi ne comprenait-il pas, lui égoïste et faux philosophe, tout ce que révèle de gratitude sincère et de sentimentalité naïve le culte rendu à l'homme de la Roche, à ce Jean Kleberger auquel une statue est élevée, à ce titre unique qu'il a laissé dans la mémoire de tous le renom d'une inaltérable bonté ? A peine le connaît-on ! Sur sa véritable personnalité, les détails manquent. Seulement il fut serviable, généreux, et c'est à la Bonté que le monument est érigé. Ceci rappelle le Dieu inconnu des anciens, avec une nuance plus touchante.
Et cet autre souvenir, celui de la Belle Allemande, n'est-il pas empreint d'une poésie sombre et dramatique ?
Voici que, suivant la Saône, vous avez vu passer les charmants paysages de Neuville, de Fontaines et de Collonges. L'île Barbe émerge de l'eau, avec ses roches qui la hérissent, avec ses ruines se découpant sur le ciel. Alors vous apercevez une tour antique, se dressant sur le quai de Serin.
C'est - dit Charavay - le donjon féerique des Lyonnais. Il n'est sorte de fables qu'on n'ait racontées sur cette demeure féodale.
Selon une vieille chronique restée manuscrite (Appendices historiques pour servir à l'histoire de la Tour Barbare, par Simon Hugonet, 1632), la tour de la Belle-Allemande fut élevée en 1322 et eut d'abord 165 pieds d'élévation. Elle appartenait à la famille de Sathonay et fut vendue en 1522 à Jean Cleberg, célèbre négociant de Lyon, connu depuis sous le nom du Bon Allemand ou de l'homme de la Roche.
La veuve de Cleberg fit baisser cette tour de 53 pieds et reconstruisit le château. Après la mort de cette femme, son neveu, Brunold, prit possession de la propriété. Brunold, né à Lyon, passa en Allemagne, y acquit une grande fortune et parvint par le crédit de son oncle à de hauts emplois. Il avait reçu de l'empereur la baronne de Varistein ; mais il avait encouru sa disgrâce en épousant, malgré la volonté du prince, une simple paysanne allemande. Il quitta la cour et vint habiter le manoir des Cleberg.
Sa femme était très-belle, et lui-même enclin à la jalousie. Il conçut des soupçons sur un jeune homme qui fréquentait sa maison et, s'étant emparé de lui, le fit enfermer à Pierre Scize. Quant à sa femme, il la séquestra dans la tour dont il fit murer les fenêtres... et où elle mit vingt-sept ans à mourir...Que de sujets d'étude présente Lyon et que je n'ai pu encore effleurer !... mais voici que déjà j'ai atteint les limites qui m'étaient fixées...
Je veux cependant dire encore un mot sur le théâtre à Lyon.
Eu égard au chiffre de sa population, Lyon est peut-être, de toutes les villes de France, celle où il y a le moins de théâtres.
Tandis que Bordeaux, en première ligne, puis Marseille, Rouen, le Havre, ont un nombre de théâtres peut-être exagéré, Lyon au contraire n'en compte en réalité que trois qui méritent ce nom : ce sont :
1. Le Grand-Théâtre, situé place de la Comédie, où l'on joue tous les genres, grand opéra, opéra-comique, opérette, ballet, drame et mélodrame, comédie et vaudeville.
2. Le théâtre des Célestins (brûlé il y a quelques années, mais reconstruit aujourd'hui et dont la réouverture aura certainement lieu dans l'année 1876). Ce théâtre est situé sur la place qui porte son nom, et l'on y joue le drame, la comédie et l'opérette.
3. Le théâtre des Variétés, situé aux Brotteaux, établissement de banlieue par conséquent et d'un ordre tout à fait secondaire, dans le genre des théâtres de Belleville et de Batignolles à Paris.
A la suite de l'incendie du théâtre des Célestins, une nouvelle salle s'est ouverte au public : c'est celle du Gymnase, située quai Saint-Antoine. Autrefois théâtre d'amateurs, ce petit établissement s'est transformé peu à peu, et grâce à l'intelligence de son directeur, a su prendre auprès du public lyonnais la place du théâtre des Célestins incendié.
Comme monument extérieur, le Grand-Théâtre rappelle le théâtre de l'Odéon, avec sa façade à colonnes, et sa galerie circulaire où sont installées diverses petites boutiques de librairie et d'articles de Paris. La salle est vaste, mais irrégulière, avec un grand balcon en forme de corbeille, quatre étages de loges et galeries, un orchestre et un parterre. Ce théâtre était administré, concurremment avec celui des Célestins, par un directeur choisi par la ville. Depuis l'incendie de ce dernier, il a son directeur spécial.
Plusieurs de ceux qui ont dirigé ces théâtres y ont fait leur fortune, comme MM. Délestang et Dherblay, ou du moins l'ont commencée, comme MM. Halanzier et Raphaël Félix.
Mais il faut reconnaître qu'avec le Grand-Théâtre seul les résultats de l'exploitation se traduisaient par des pertes, et que le théâtre des Célestins produisait des bénéfices considérables. En réalité le théâtre des Célestins a souvent soutenu le Grand-Théâtre.
Cela s'explique facilement. Si le public lyonnais qui va au théâtre est peu nombreux proportionnément au chiffre de la population, il est en revanche très exigeant. Les débuts des artistes de grand opéra et d'opéra-comique, lesquels ont généralement lieu au mois de septembre, ont été bien souvent l'occasion de véritables émeutes, et l'on a vu des escadtons entiers de cavalerie occuper en armes la place de la Comédie pendant les représentations qui servaient de dernières épreuves à des chanteurs contestés.
Certains directeurs eux-mêmes, comme M. Raphaël Félix, qui depuis a dirigé le théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris, s'étaient fait prendre en telle animadversion par le public lyonnais, que la salle a été en pleine révolution ; le public a démonté les fauteuils d'orchestre, les a jetés sur le théâtre, a envahi la scène, et la troupe a dû faire irruption dans la salle pour rétablir l'ordre et arrêter les intransigeants.
Quand on songe que ces scandales avaient lieu tout simplement parce qu'un ténor avait lancé un ut de tête, tandis que le public avait l'habitude de l'entendre de poitrine, ou bien parce qu'une chanteuse légère avait baissé un air d'un demi-ton, on ne peut s'empêcher de sourire, surtout en rapprochant ces colères souvent peu motivées de l'excessive bénignité du public parisien, lequel supporte des médiocrités qui ne seraient certainement pas écoutées cinq minutes à Lyon. Ce qui n'empêche pas de prêcher l'indulgence aux Lyonnais.
Je reconnais cependant que le Lyonnais est un amateur musical de premier ordre, et j'ai été souvent surpris du tact que j'ai reconnu chez ces négociants tout hérissés de chiffres. Plus musiciens que littérateurs, ils recherchent la distraction facile qui s'impose à l'imagination sans fatigue.Après le travail, le véritable délassement. Aux ouvriers, la partie de boules ; aux bourgeois, les cafés-concerts et les petits théâtres ; aux délicats, l'opéra. Puis, par-dessus tout, les promenades du dimanche à la campagne. Ce jour-là, tout Lyon est hors Lyon, à la Roche-Cardon, à la Mulatière, aux Etroits, chez la mère Guy aux matelottes renommées, aux Aqueducs.
L'homme, rejetant ses soucis pour un jour, redevient enfant.
Et dans ces heures d'insouciance, il puise la force de recommencer son travail incessant.J'ai achevé ma tâche, de façon peut-être bien incomplète.
Puissent les lecteurs tenir compte à l'auteur de son bon vouloir et partager les sincères sympathies que doit inspirer à tout Français Lyon, la grande cité de travail et de progrès !JULES LERMINA